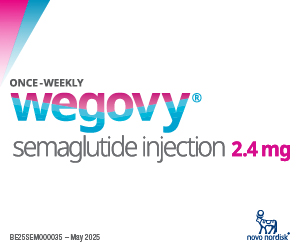François Burhin : « Aujourd’hui, Epicura existe sur la carte des hôpitaux belges »
Depuis dix ans à la tête de l’Hôpital intégré Epicura, François Burhin connaît pourtant les murs de l’institution depuis sa fusion, démarrée bien avant en 2007. Entre les leçons tirées et les défis de la prochaine décennie, il garde comme fil conducteur l’attention sur l’ancrage socio-régional de l’hôpital.

Le journal du Médecin : Une grande partie de votre carrière est liée au domaine hospitalier. Comment avez-vous vu le paysage évoluer ?
François Burhin, directeur d'Epicura : J’ai passé 25 ans de ma carrière dans la consultance et j'ai pas mal travaillé dans le domaine hospitalier, notamment sur des projets de fusion et de regroupement hospitalier. Depuis que j’y travaille, il y a des regroupements. C’est un secteur qui se concentre. Dans le temps, il y avait un hôpital dans chaque village, maintenant, ils sont tous fusionnés. Ils doivent être moins d’une centaine en Belgique aujourd’hui.
Pourtant, l’institution Epicura, vous la connaissez depuis ses débuts…
La fusion qui a donné naissance à Epicura a été réalisée en 2012. Je suis arrivé en 2014 pour faire un management d'intérim parce que le directeur de l'époque avait quitté Epicura pratiquement du jour au lendemain pour l’Institut Jules Bordet. J’avais participé au démarrage de la fusion en 2007. Ce sont des processus qui prennent du temps. Cinq ans pour faire une fusion, c’est assez normal. Je l’ai vu en participant à la création du GHDC et de Vivalia.
La première étape, c’était de structurer, de créer une seule entité. D’ailleurs, Epicura n’est pas un réseau hospitalier, c’est un hôpital intégré. L’année 2014-2015 a vraiment servi à réaliser cette intégration. Ce qui m’a marqué à cette époque-là, c’est vraiment cet énorme travail de l’ombre qui consistait à n’avoir plus qu’un seul comité de direction, qu’un seul conseil médical, qu’un seul modèle de contrat, qu’un seul système de rémunération des médecins. Ça prend énormément de temps parce qu’il y avait des systèmes de rémunération différents. Selon qu'on faisait un acte à un endroit ou à un autre endroit, on n'était pas payé la même chose. Forcément, il y en avait un qui gagnait bien et l'autre qui gagnait moins bien. Alors, soit on faisait la moyenne et l’un était moyennement content et l’autre moyennement mécontent, soit on trouvait de nouveaux systèmes. Il fallait toujours se projeter un peu vers l'avenir pour essayer de dégager des consensus parce que faire bêtement les moyennes, ça n'allait pas.
À la fin de l’année 2014, je me souviens qu’il y a eu une assemblée générale médicale pour voter tous les changements : la nouvelle réglementation générale médicale, le nouveau contrat des médecins, le nouveau système de rémunération… C’est passé vraiment tout juste. En fait, c’était comme une deuxième fusion, trois ans après. C’est à partir de là que ça a commencé à aller dans un autre sens, vers une collaboration des personnes. Disons que jusque là, c'était surtout une fusion sur papier, une fusion des propriétaires. Les associés avaient fusionné, mais les gens n'avaient pas fusionné, ils ne travaillaient pas ensemble. Ça, c'est une de mes grandes fiertés du début : c'est d'être parvenu à cette intégration. Tous les hôpitaux qui fusionnent aujourd’hui vivront ces difficultés.

"Les universités savent qui on est"
Comment Epicura a-t-elle évolué, par rapport à 2014 ?
Je pense que la différence entre il y a dix ans et maintenant, c'est qu’Epicura, c’est un hôpital qui existe sur la carte des hôpitaux belges. Pas simplement hennuyers ou wallons, belges. Car on s’inscrit dans des projets, on est volontaires pour être dans des initiatives au niveau de l'innovation. Quand on interroge les universités, elles savent qui on est. C’est bien car les futurs diplômés peuvent postuler chez nous.
Ces dix dernières années, l’actualité n’a pas toujours été rose… Qu’en retirez-vous ?
Beaucoup d’autres choses se sont passées. En mars 2020, le covid a frappé très fort la région de Mons-Borinage. Ça a été très prenant, pendant trois semaines que j’appelle « mes trois semaines de guerre » ou « trois semaines en enfer ». Il y a encore eu le covid pendant deux ans, mais on s'y habitue. On s'habitue à tout.
Plus récemment, en 2022, Epicura a fait une perte. C'était un petit séisme parce qu’en tant qu’ASBL, Epicura faisait du boni et ça paraissait presque naturel d'en faire depuis dix ans. C’était quand même une fierté, même s’il n’était pas riche, d’avoir un hôpital qui faisait toujours du boni. Sauf qu’une année, on n'en a pas fait. C’était l'année où y a eu beaucoup d'inflation. Il a fallu mettre en place des mesures de gestion.
Les valeurs, boussole dans le brouillard de la permacrise
Comment avez-vous surmonté les multiples crises de ces dernières années ?
Heureusement, on n'est pas tout seul. Il y a un comité de direction très solide et très expérimenté à Epicura. Je peux vraiment être très fier des collègues plus malins que moi. Une bonne équipe, c’est la seule manière de bien travailler.
Comment surmonter ces crises ? J'ai le sentiment que par rapport à il y a dix ans, il y a une accélération considérable des choses. On vit dans un monde qui va beaucoup plus vite, qui est beaucoup plus intensif, et, disons-le, beaucoup plus sujet aux crises. Je trouve le terme de « permacrise » particulièrement juste. Il y a eu le covid, l'inflation, il y a la guerre, la crise des matériaux, les cyberattaques ; aujourd’hui, Trump nous fait des crises quasiment tous les jours...
Je pense qu’il y a plusieurs manières de les affronter. D’abord par la résilience et l’agilité, c’est sûr. Mais, fondamentalement, ce qui permet de surmonter les crises, c'est d'avoir des valeurs solides, parce qu’on peut toujours s'appuyer dessus : il y a toujours un point fixe qui fait qu’on sait où on est et où on va. Il faut bien sûr s’adapter aux sollicitations qui viennent de l’extérieur, mais si on sait où on va, on ne doit changer que le « comment », pas le « pourquoi ».
Vous évoquez le futur. Ca fait dix ans que vous êtes à la direction d’Epicura. Vous êtes reparti pour dix nouvelles années ?
(rire) Ça va me conduire un peu trop loin, je crois. Pour le futur, d’abord, j'aimerais bien sécuriser tous les projets en cours à Epicura, notamment les projets au niveau de l’infrastructure. Je crois qu'on est toujours en train de devenir cet hôpital à vocation régionale.
Puis alors, et c’est peut-être un peu naïf, je crois que s’il y a une très bonne équipe, c'est déjà une bonne assurance pour affronter le futur. Quand je travaillais dans la consultance pour une société danoise, j'avais un patron qui disait que c'était « people before strategy ». Je crois que j'ai gardé cette idée-là : on peut avoir des bons plans, une excellente stratégie, c'est bien, et c’est important, mais si on n’a pas les bonnes personnes, on n’arrivera jamais à réaliser sa stratégie.

Le défi des talents
Dans les dix prochaines années, quels seront les plus gros défis pour Epicura ?
Ce sera surtout le défi des talents. Il faut non seulement pouvoir les attirer et les retenir, ça c’est classique, mais aussi pouvoir tenir compte des nouvelles aspirations des gens. Les choses ont beaucoup évolué par rapport à il y a dix ans. Il faut qu'on apprenne à travailler avec des personnes qui ont envie de s’investir autrement dans leur travail. Pour quelqu’un comme moi, qui ai bientôt 60 ans, accepter ce changement socioculturel demande un travail sur soi-même. Il faut se mettre dans la peau de ceux qui constituent notre force de travail. Il y a 3.000 travailleurs chez Epicura et parmi eux, énormément ont moins de 30 ans.
Vous faites allusion à ce changement de paradigme chez les médecins qui ne veulent plus consacrer toute leur vie et 60 h/semaine à la médecine ?
C'est une évidence. Une maître de stage m’expliquait que quand elle était assistante, elle faisait dix gardes par mois. Aujourd’hui, les assistants chez elle en font deux par mois, et les choisissent. De la même manière, parmi les jeunes médecins, il y en a quand même beaucoup qui prennent des contrats à temps partiel, même dans des disciplines en pénurie où il y a largement assez d’activité. Mais on voit des changements dans plus ou moins toutes les professions, avec beaucoup d'employés qui demandent à avoir du télétravail, certains s'intéressent à leurs congés, des revendications se traduisent parfois par la demande d’avoir un jour de congé supplémentaire plutôt qu’une augmentation.
Ne pas avoir honte des partenariats avec l'industrie
Impliquez-vous les patients dans la gouvernance d’Epicura ?
On essaie. Tout le défi, c'est évidemment de mettre le patient au début de la chaîne. Il va lui même définir ce dont il a besoin. On peut également conclure une sorte de parcours qui est un contrat avec le patient. Dans le futur, ce sera probablement davantage comme ça. Mais déjà aujourd’hui, les patients sont plus instruits. Ils font plus de shopping, s'intéressent à l'offre existante et reçoivent de moins en moins les conseils du médecin comme paroles d'évangile.
Au-delà de votre fonction, êtes-vous impliqué dans d'autres projets ou d'autres initiatives ?
Dans mes activités parallèles, je me suis notamment investi dans la centrale de marché, qui s'appelle l'Acah, dont je suis le président du conseil d'administration et qui regroupe une dizaine d'hôpitaux. Donc ça me prend un peu de temps. Et en tant que directeur de l'hôpital, je m'implique depuis des années déjà dans l'Association belge des directeurs d'hôpitaux. Je trouve ça très intéressant parce que c’est une association nationale. Cela permet de garder le contact avec les collègues flamands, bruxellois et wallons.
Ça, pour moi, c'est très important. Je suis bruxellois d'origine, bilingue. On y apprend énormément de choses, sinon on reste en Wallonie avec nos 33 hôpitaux… L’association est aussi un partenariat avec l'industrie. Comme j’ai passé 25 ans dans le secteur privé, je trouve qu’il n'est pas honteux d'avoir des liens avec l'industrie. L’industrie a des clients chez nous, dans d’autres pays, qui ont des exigences. Elle innove dans ses grands départements de recherche et développement, et peut nous partager des expériences sur des évolutions qui se passent en dehors de notre petit monde. Donc c’est vraiment très riche.
Un hôpital labellisé RSE
Le journal du Médecin : En avril dernier, Epicura a reçu le label RSE des mains d’Afnor Certification. Une reconnaissance pour votre hôpital ?
François Burhin : L'aspect RSE est quand même un point important de notre hôpital. À la base, on était plutôt partis sur une politique environnementale de développement durable pour Epicura en 2018. On a signé une charte, puis on a élargi un petit peu le concept pour développer une politique RSE. Elle ne concerne pas que l'environnement, c'est aussi l'inscription dans le terrain local, notamment avec les communes, et surtout des actions de promotion de la santé.
L’hôpital est historiquement un acteur du curatif. Notre business model, c’est de soigner des gens, essentiellement de manière curative. Mais on a une grosse action qui n'est pas nécessairement valorisée budgétairement, en termes de prévention, de dépistage, d’éducation à la santé, de protection de la santé avec les acteurs locaux ou en sortant de nos vieux murs… Pour certaines personnes très défavorisées de la région, les consultations de dépistage organisées à l’occasion d’une journée mondiale d’une maladie, c'est parfois le seul contact avec un médecin qu'elles vont avoir pendant l'année ! Pour nous, c'est donc vraiment très important. Ça fait partie du rôle social de l'hôpital.
Ça parait parfois contre-intuitif, parce que si on regarde ça d'un point de vue économique, ce n'est pas très intéressant pour l'hôpital « en tant qu’hôpital » mais, par contre, c'est intéressant pour la santé publique, et je pense que notre mission c'est quand même un peu d’être un acteur de la santé publique avant d'être un acteur économique. Si le but final est d'avoir une meilleure santé pour la population, ce que je crois, alors il faut que les acteurs soient tous orientés vers ce but-là. À la place d’une médecine à l’acte, telle que pratiquée en grande partie actuellement, je serais partisan d’un trajet patient avec des forfaits et essayer d'optimiser l'organisation. Un système de rémunération à l’acte nous mène droit dans le mur. C’est un peu ce qu'on a essayé de plaider au niveau de l’ABDH avec le value based healthcare, une logique où l’on rétribuerait ce qui apporte de la valeur et pas simplement où l’on rétribuerait la production.
F.H.