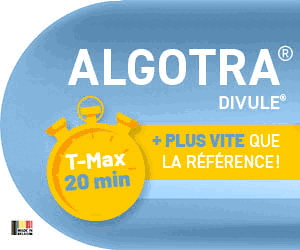Gilbert Bejjani : « Réformer sans rompre, fédérer sans s’effacer »
Le 24 mai prochain, l’Absym élira son nouveau président. Parmi les candidats, Gilbert Bejjani, revendique aujourd’hui une ligne de réforme construite, une méthode plus consensuelle et une ambition : redonner sens à l’action syndicale dans un paysage médical en recomposition. Il se présente avec un projet clair, une posture assagie et un mot d’ordre : construire, enfin.
Il fut longtemps perçu comme le trublion de l’Absym. Présent dans les médias, incisif dans le verbe, trop bruyant pour certains, trop isolé pour d’autres. « Disruptif », admet-il lui-même. « Peut-être trop. » Gilbert Bejjani ne nie rien. Mais aujourd’hui, c’est un candidat à la présidence qui s’exprime, avec un cap différent : « Je ne veux pas être partout, je ne veux pas être seul. Il faut une équipe, il faut un collectif. »
Âgé de 51 ans, anesthésiste, engagé de longue date dans la structure syndicale, Gilbert Bejjani se veut à la fois réformateur assumé et rassembleur lucide. « La fonction fait l’homme. En tant que président, on n’a pas à être clivant. On doit fédérer. »
Il ne prétend pas avoir changé : il revendique au contraire une continuité dans les idées, mais une évolution dans la posture. Une posture dictée par le rôle qu’il occupe et les responsabilités qu’il assume. Ce qu’il défend aujourd’hui : un syndicat plus audible, plus structuré, plus crédible.
« Je suis un médecin parmi d’autres. Mais je suis aussi un des rares à avoir fait le tour des hôpitaux, des présidences de conseils médicaux, à avoir parlé à tout le monde. J’essaie de défendre tous les types de pratiques, salariés, indépendants. Et je veux sortir des silos, même ceux entre spécialités, médecine générale incluse. »
Du “non” au “oui, mais” : une nouvelle méthode syndicale
C’est peut-être le changement le plus fondamental qu’il propose : non pas un virage idéologique, mais un tournant stratégique. Là où d’autres s’arc-boutent sur une logique d’opposition, Gilbert Bejjani plaide pour une méthode de négociation plus subtile, plus moderne, fondée sur le « oui, mais ».
« On ne peut plus se contenter de dire non à tout. Ce n’est pas une posture tenable face à un État qui peut légiférer, imposer, arbitrer. Le seul vrai levier qu’on a, c’est la capacité de construire un projet. Sinon, on perd à tous les coups. »
Ce “oui, mais” n’est pas un renoncement. Il s’agit, selon lui, d’un moyen d’exister dans un rapport de force structurellement déséquilibré. « Les médecins sont minoritaires dans les instances de décision. Si tu arrives les bras croisés en répétant ton refus, tu seras contourné. La clé, c’est d’arriver avec une proposition claire, argumentée, documentée. »
L’enjeu, selon le Dr Bejjani, est de réhabiliter une parole médicale crédible et audible, capable d’embarquer les politiques, les mutuelles, les autres professions, sans se diluer. « Je ne dis pas qu’il faut tout accepter. Je dis qu’il faut arriver à infléchir, à orienter, à façonner les projets. Si tu n’es pas dans la salle, on écrira la réforme sans toi. »
Réformer un système “à bout de souffle”
Derrière la méthode, il y a un projet. Et derrière le projet, une conviction : le système actuel ne tient plus. Gilbert Bejjani le répète à l’envi : « On ne va pas s’en sortir avec des rustines. Il faut une réforme structurelle, massive. »
Il insiste sur la nécessité de sortir d’une logique doctrinaire, trop souvent enfermée dans des slogans ou des principes abstraits, pour entrer dans une logique de projet concret, chiffré, négociable. « La liberté thérapeutique, la responsabilité, la solidarité, ce sont des valeurs importantes. Mais elles ne servent à rien si elles ne s’incarnent pas dans un modèle de soins crédible et soutenable. »
Son plan se décline en trois volets, dans le cadre d’une vision Quintuple Aim: la nomenclature, le financement des hôpitaux, et l’intégration des soins.
1. Réécrire la nomenclature
Il en fait le cœur de la relance syndicale. Gilbert Bejjani dénonce un système « purement quantitatif », où l’on a « péché par le volume ». Trop d’actes, trop peu de valeur unitaire, trop d’inégalités entre spécialités. Il revendique un recentrage sur le soin pertinent, dans la lignée du value-based healthcare – qu’il défend de longue date : rémunérer justement les prestations utiles, en tenant compte du temps, de la complexité, de l’impact. « Je suis favorable à l’acte. Je suis favorable aux suppléments. Mais pas à une médecine où le volume remplace la valeur. La nomenclature doit redevenir un outil de qualité, et les prestations médicales doivent rester la propriété des médecins. C’est cela une profession libérale. »
Il se dit prêt à discuter avec chaque spécialité pour identifier les zones de surutilisation. Objectif : récupérer des marges d’efficience à réinvestir dans la valorisation des consultations, des gardes, de la téléconsultation et ce dès aujourd’hui, même avant l’aboutissement de la réforme.
« À court terme, si des marges peuvent être dégagées grâce à une amélioration assumée de l’efficience, il conviendrait de revaloriser la consultation, les actes chirurgicaux à faible valeur, la permanence et la disponibilité des médecins généralistes et spécialistes, tout en soutenant les outils numériques, notamment les téléconsultations », ajoute Gilbert Bejjani.
2. Clarifier les flux financiers à l’hôpital
Le Dr Bejjani demande une séparation nette entre les honoraires médicaux et les frais hospitaliers, « même si ces derniers peuvent rester affectés au budget des médecins – et c’est normal – ce sont des frais de prestations qu’il faut pouvoir évaluer de concert avec les hôpitaux ». Il déplore une confusion des budgets, un système opaque de rétrocessions, et un dialogue souvent biaisé. « On a laissé les hôpitaux capter une partie de la rémunération médicale. Il faut remettre de la clarté. »
Il rappelle les avancées récentes – notamment l’arrêté royal de 2023 sur les rétrocessions – mais insiste : ce n’est qu’un début. Pour lui, défendre la médecine libérale, ce n’est pas défendre l’inaction, c’est exiger des règles claires.
3. Réconcilier les lignes de soins
Enfin, il appelle à une vraie réflexion sur l’articulation entre la première et la deuxième ligne. « Le vieillissement, la chronicité, le manque de personnel nous obligent à repenser les parcours. » Il refuse le dogme d’un modèle unique, mais propose de tester des modèles hybrides, où les professionnels définissent ensemble les bons itinéraires cliniques. « La subsidiarité, oui. Mais pas si elle devient un prétexte pour piquer des actes aux médecins. Le bon soin, au bon endroit, par le bon professionnel. C’est ça, la valeur. »
Suppléments : vers un encadrement intelligent
Sur les suppléments, Gilbert Bejjani avance de manière équilibrée. Il assume de les défendre, mais pas à n’importe quel prix. Pour lui, ils incarnent un modèle de santé mixte qu’il juge indispensable, à condition de le réguler. « Ce n’est pas une question morale. C’est une question d’organisation. Le supplément, ce n’est pas un luxe, c’est un levier. »
Il mobilise un concept inattendu dans le débat : celui de partenariat public-privé (PPP). « Dans d’autres secteurs, c’est crucial et même bienvenu, et cela existe de la recherche jusqu’aux entreprises. Pourquoi le refuser en santé ? Le supplément, c’est une manière de faire entrer des ressources privées dans un système public sous-financé. » Et de citer l’exemple d’hôpitaux portugais mi-publics, mi-privés, ou des universités à double financement.
Mais il met aussi des garde-fous. Il faut, dit-il, éviter trois dérives :
- Que le supplément devienne un obstacle à l’accès aux soins ;
- Qu’il devienne l’unique motivation du travail ;
- Qu’il masque la faiblesse du tarif de base – « On ne peut pas limiter d’un côté et réduire la valeur financée de l’autre ! », précise le Dr Bejjani.
« La vraie question n’est pas : faut-il des suppléments ? C’est : pourquoi des médecins se déconventionnent-ils en masse ? Parce qu’à 30 euros la consultation, ils ne tiennent plus. C’est le modèle qu’il faut revoir, pas les médecins qu’il faut blâmer. Ce n’est pas une responsabilité individuelle, mais collective. Dans les faits, l’individu médecin souffre, se bat pour maintenir un équilibre privé-professionnel et une rémunération adéquate. »
Il défend un modèle de conventionnement « intelligent », où une partie de l’activité resterait conventionnée, et une autre – encadrée par des critères d’horaire, de type d’acte ou de lieu – pourrait ouvrir des marges supplémentaires. Il appelle aussi à plus de transparence, sans stigmatisation.
Et de conclure : « On ne protège pas les patients vulnérables en tirant tout vers le bas. On les protège en assurant un vrai choix, une transparence et un accès à un soin de qualité, sans culpabiliser ni les médecins, ni les malades. »
Refonder l’Absym de l’intérieur
S’il y a un point sur lequel Gilbert Bejjani se montre intransigeant, c’est bien celui-là : la gouvernance interne de l’Absym ne fonctionne plus. Il dénonce une structure « verrouillée », des décisions « court-circuitées », des présidents de chambre « mis de côté » et une dynamique fédérale « parfois réduite à un cinquième clan ». Le mot est dur, mais assumé.
« Aujourd’hui, on fonctionne à coups de votes de conseil d’administration sans même avoir consulté les chambres dans certains cas. Ça n’est plus un collectif, c’est une juxtaposition de rapports de force. »
Il plaide pour un fonctionnement plus respectueux de la logique fédérative. Il rappelle que les membres de l’Absym sont les chambres elles-mêmes, pas les individus, et qu’à ce titre, les présidents de chambre doivent être au cœur du processus décisionnel. Sa proposition : créer un "kern" des présidents, sur le modèle d’un exécutif resserré, qui prépare les orientations et assure un minimum d’alignement politique entre les entités.
Autre exigence forte : le respect de la parité linguistique, y compris au sein des groupements francophones. « Si une chambre wallonne concentre toutes les voix francophones, et que Bruxelles se retrouve marginalisée, on affaiblit tout le monde. On affaiblit même notre poids face aux néerlandophones. D’ailleurs la logique ‘régionale’ n’est pas absolue, il s’agit d’une recherche de la proximité avec la base, sur les régions, provinces et ville mais aussi grâce au maillage des universités et des réseaux formels et informels. Nous accueillons d’ailleurs avec plaisir les néerlandophones à Bruxelles aussi et c’est normal. »
Il ne cache pas que cette marginalisation, s’il devait en subir les conséquences, pourrait le conduire lui-même à envisager un départ : « Quand un partenaire est systématiquement exclu, on ne peut plus parler d’un projet commun. Ce n’est plus une question d’idéologie, c’est une question de gouvernance. » Il évoque notamment le non-respect de la parité francophone entre chambres, et le risque de voir l’Absym Bruxelles poussée dehors, faute d’espace réel de concertation.
Mais au fond, c’est une critique constructive que Gilbert Bejjani formule. Ce dernier veut reconnecter la structure avec le terrain, restaurer la légitimité démocratique, et rappeler que le syndicat n’existe que s’il est lisible pour ses membres. « Beaucoup pensent encore qu’ils sont à l’Absym parce qu’ils cotisent au GBS. Il faut sortir de ce flou. Il faut reconstruire du lien. »
L’homme derrière le candidat
Gilbert Bejjani ne prétend pas avoir changé de nature. Il insiste au contraire sur l’idée que la fonction définit le rôle. « En tant que médecin, je défends la médecine. En tant qu’anesthésiste, je défends ma spécialité. Mais en tant que président, je représente tous les médecins. Et je dois être fédérateur. »
S’il a longtemps été perçu comme un électron libre, parfois trop présent dans les médias, il s’en explique : « Quand on ne peut pas défendre ses idées en interne, on finit par les porter ailleurs. » Ce n’était pas, assure-t-il, une stratégie de rupture, mais une tentative de faire émerger des propositions dans un espace qui, selon lui, ne les accueillait pas.
Quand on évoque avec lui le parallèle de trajectoire avec Pierre Poilièvre, le conservateur canadien longtemps vu comme clivant avant d’être vu – paradoxalement dans sa récente défaite – comme potentiel futur leader national, il ne balaie pas la comparaison. Il s’en amuse, même : « Oui, ça me parle. J’ai été vu comme clivant. Mais aujourd’hui, je pense que ceux qui m’écoutent comprennent que je suis surtout réformateur. »
Son ton s’adoucit quand il parle des jeunes médecins qu’il appelle régulièrement « pour prendre le pouls », des confrères en burnout, des structures collectives qui vacillent. Derrière le projet politique, se dessine une inquiétude sincère pour un système qu’il sent au bord de la rupture. Et une volonté de ne pas s’y résigner. « Je n’ai pas envie d’imposer. J’ai envie de construire. J’ai envie qu’on travaille ensemble. Et j’ai envie qu’on se respecte. C’est ça, être président. »
Lui qui a longtemps été vu comme celui qui dérange, se pose désormais en garant du jeu collectif. Il n’a peut-être pas changé de convictions. Mais il veut les porter autrement. « Ce que je propose, je le ferai si je suis élu. Mais je le dirai même si je ne le suis pas. Parce que l’Absym mérite mieux que des jeux de pouvoir. Elle mérite un projet. Un cap. Et de retrouver ses lettres de noblesse. Qui qu’il soit, la tâche du futur président sera colossale face aux enjeux et à la crise. »