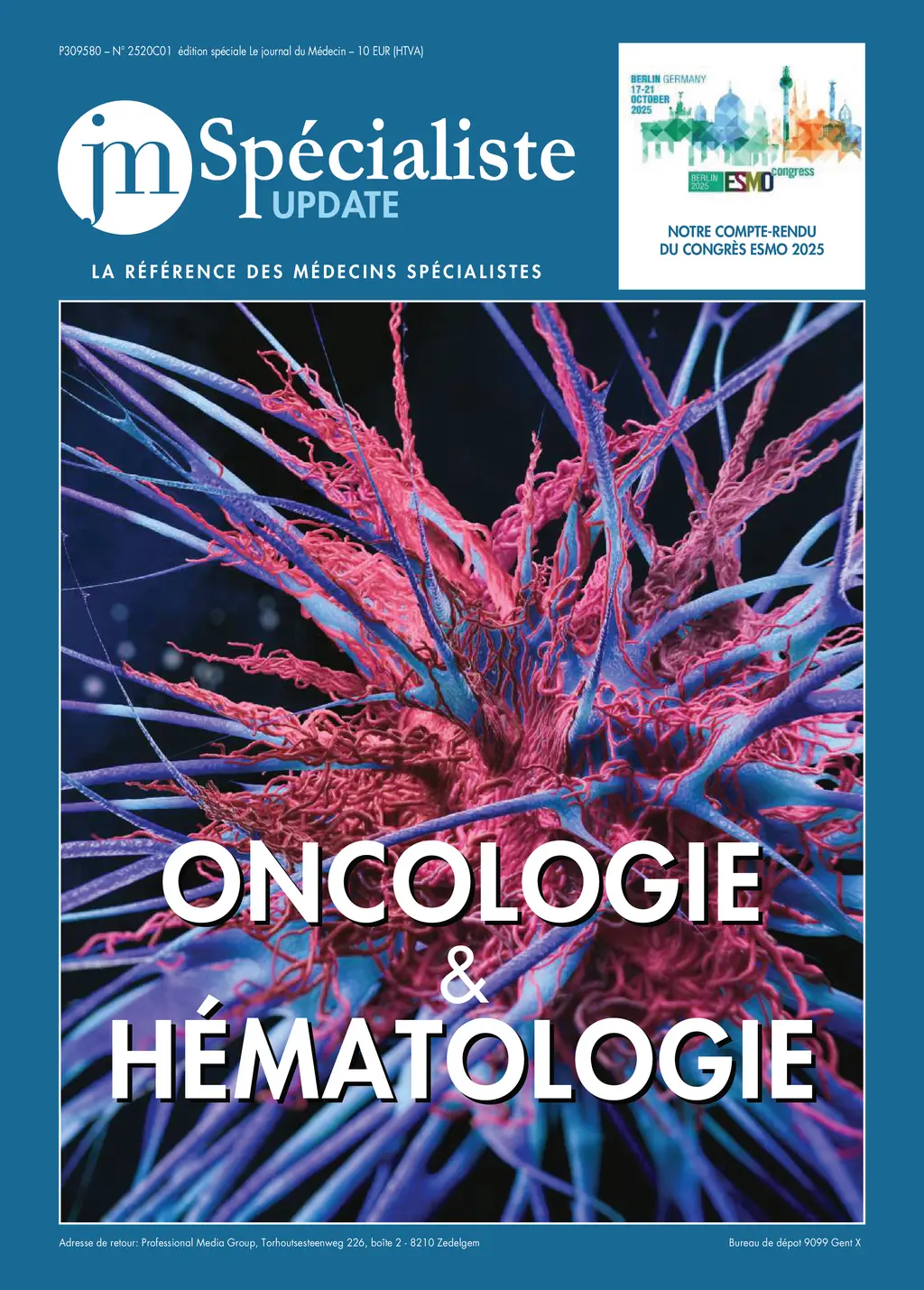Mutualité chrétienne
Elise Derroitte (I): « Il faut remettre le soin au centre »
La vice-présidente de la Mutualité chrétienne, Elise Derroitte, comprend la réaction des médecins à propos du budget. « Il a fallu trouver très rapidement des économies. Dans la structure du budget, il est difficile de chercher des économies en dehors des trois grands secteurs : la pharma, les hôpitaux et les médecins. » Quant à sacrifier l’extra-muros, elle défend les patients, moins protégés financièrement en-dehors de l’hôpital. Première partie de son interview en version intégrale.

Le Journal du médecin : Ce qui m'a frappé cette année (je suis au Journal du médecin depuis 1996, NdlR), c'est que les syndicats médicaux et les hôpitaux étaient en état de choc face aux économies demandées. Les hôpitaux évoquent même 160 millions d'économies indirectes. Vous avez voté en faveur du budget, je crois. Comprenez-vous leur désarroi ou leur choc ?
Elise Derroitte. : Oui, bien sûr que nous comprenons leur réaction, nous en avons beaucoup discuté avec eux. Cette proposition s'inscrit dans le cadre de la lettre de mission, établie cette année pour la première fois afin de déterminer la provenance des économies.
Êtes-vous satisfaite de cette lettre de mission ?
Non, nous n'y étions pas du tout favorables au départ. Nous estimons qu'elle limite la capacité de négociation de la gestion paritaire. Nous l'avons exprimé très clairement.
Au Comité de l'assurance ?
Oui, au Comité de l'assurance et auprès du ministre. Nous étions déjà très critiques lors des accords de gouvernement. Cependant, une fois cette lettre de mission établie, elle fait partie du cadre budgétaire que nous devons respecter pour soumettre une proposition au comité de l'assurance. Nous avons tenté d'élaborer une proposition relativement équilibrée et basée sur les soins appropriés. Nous voulions que les économies touchent le moins possible la poche du patient. Notre objectif était que le patient bénéficie de la même qualité de soins sans avoir à payer davantage. Nous pensions que des économies pouvaient être trouvées en ciblant les soins inappropriés, comme les mesures concernant les CT-scans ou l'excès de biologie clinique. Ces mesures impactent indirectement les ressources des hôpitaux, nous en sommes conscients, et c'est ce qui a provoqué la réaction des hôpitaux. Une grande partie des coûts indirects provient également des produits pharmaceutiques (pharma), notamment des pharmacies hospitalières. Compte tenu des contraintes budgétaires, il est difficile de trouver des économies en dehors de ces trois grands secteurs : la pharma, les hôpitaux et les médecins, car les autres postes budgétaires sont assez réduits. Les débats avec les syndicats de médecins et les représentants des coupoles hospitalières ont davantage porté sur la pertinence idéologique de réaliser des économies dans le secteur des soins de santé, plutôt que sur la provenance de ces économies. Les syndicats de médecins affirmaient être d'accord pour être responsabilisés sur leurs dépassements, mais refusaient de faire des économies, ce qui est un débat beaucoup plus idéologique que le volume d'économie en lui-même.
« Le volume d'économies que nous devions réaliser pour 2026 s'est heurté aux évolutions à plus long terme qui étaient en cours, telles que la réforme hospitalière ou la réforme de la nomenclature. »
Que répondez-vous lorsqu'ils affirment que ces économies ne sont pas vraiment basées sur l'EBM (Evidence Based Medicine) et qu'elles sont trop linéaires, rappelant l'époque des années 90 avec Marcel Colla et Magda De Galan ? Ils souhaitent collaborer à une autre vision, mais estiment que l'approche actuelle n'est pas basée sur l'EBM.
Je peux les rejoindre sur un certain nombre de mesures, mais ce n'est qu'une partie du problème. Lors des discussions que nous avons eues avec les médecins et les hôpitaux pour préparer le budget (y compris lors de notre dernière proposition sur les 150 millions), ils ont trouvé que les mesures proposées, notamment pour les radiologues et en biologie clinique, étaient pertinentes. Les débats portaient donc davantage sur la légitimité d'aller chercher autant d'argent dans ce secteur que sur la pertinence des mesures. J'ai en fait moins entendu de critiques sur le fait que ce n'était pas evidence based. Certes, il y a eu des mesures plus linéaires, en particulier dans la deuxième proposition du ministre, comme les diminutions concernant la cataracte. Cela nous amène à un autre point : le volume d'économies que nous devions réaliser pour 2026 s'est heurté aux évolutions à plus long terme qui étaient en cours, telles que la réforme hospitalière ou la réforme de la nomenclature. Bien que nous essayions de travailler avec des objectifs de soins de santé annuels et basés sur l'EBM, nous avons été rattrapés par la vitesse à laquelle nous devions réaliser ces économies.
Par exemple, l’Absym estime que l'extramuros est sacrifié. Elle affirme que l'extramural est nécessaire pour que les hôpitaux puissent disposer de médecins privés en dehors de l'hôpital, afin de pallier les pénuries et de désengorger les structures. Que répondez-vous à cela ?
Nous constatons que dans le virage ambulatoire, beaucoup d'attention a été portée à la protection du patient à l'intérieur de l'hôpital, notamment avec l'interdiction des suppléments sur les chambres à deux lits. Cependant, nos baromètres hospitaliers indiquent qu'il y a un déplacement vers le virage ambulatoire, et ce déplacement protège beaucoup moins le patient, car la régulation sur le paiement des suppléments y est bien moindre. Nous sommes favorables à ce que des activités sortent de l'hôpital, mais à condition que le patient soit protégé dans ses droits et qu'il ait accès à un médecin conventionné quand il en a besoin. Un virage ambulatoire complet sans aucune régulation ou attention portée à l'accessibilité à un tarif conventionné risque d'exclure une grande partie des patients, en particulier les plus précarisés.
La charrue avant les boeufs
Concernant les suppléments hospitaliers, on reproche le fait que les grandes réformes (nomenclature, paiement des médecins, actes médicaux, et les charges de fonctionnement) ne soient pas encore abouties, alors que l'on s'attaque déjà aux suppléments. Êtes-vous d'accord qu'il faudrait attendre que toutes ces réformes soient réellement implémentées ?
Sur la logique du système, je suis assez d'accord que, dans un monde idéal, il serait préférable que ces réformes aboutissent pour avoir une vision d'ensemble, car elles vont vraiment de pair. À l'hôpital, il y a la question des rétrocessions [d’honoraires] qui, pour nous, manquent de transparence. Ces rétrocessions, issues des suppléments, sont censées assurer la stabilité financière de l'hôpital. Nous sommes observateurs de cette discussion, y compris au comité de pilotage ad hoc mis en place par le cabinet sur la réforme hospitalière, car nous n'avons pas les chiffres. D'un côté, les coupoles craignent que l'on survalorise une partie de l'honoraire, et de l'autre côté, les médecins craignent l'inverse. Chacun insiste pour préserver la partie intellectuelle des honoraires ou s'assurer que les frais de fonctionnement soient suffisamment valorisés. Pour moi, il y a un réel besoin de transparence. Une étude a été menée pour tenter d'objectiver ces rétrocessions. Tout ce travail intellectuel doit aboutir à une réforme du BMF (Budget des Moyens Financiers) et à une réforme structurelle du financement hospitalier. Cela permettrait de clarifier ce qui est payé dans la nomenclature et ce qui est payé à l'hôpital. Ma crainte est que si l'on utilise les honoraires pour payer l'hôpital, cela n'est pas "propre", car cela pourrait encourager la démultiplication des actes pour assurer la pérennité d'une structure, ce qui n'est pas l'objectif. En lien avec votre première question, il faut aussi réfléchir à la politique hospitalière. Bien sûr que les hôpitaux sont impactés par rapport à l'existant, mais il faut aussi réfléchir aux besoins en lits et aux besoins hospitaliers. Le but n'est pas de continuer à financer des choses dont nous n'avons plus besoin, en raison de l'évolution des technologies et du passage accru à l'hôpital de jour ou à l'ambulatoire. Il est nécessaire de réfléchir à quel est l'hôpital du futur et comment le financer justement par rapport aux besoins de la population.

"Bien sûr que les hôpitaux sont impactés par rapport à l'existant, mais il faut aussi réfléchir aux besoins en lits et aux besoins hospitaliers."
Vous proposez des assurances hospitalisation. On vous reproche parfois d'être juge et partie, c'est-à-dire que vous souhaitez moins de suppléments pour réduire les coûts couverts par vos assurances. Vous participez aussi à la gouvernance de certains hôpitaux. Que répondez-vous à ces critiques ?
Ma vision concernant les assurances facultatives est que nous sommes conscients que le coût à charge du patient en Belgique est très élevé. Nous cherchons donc à proposer, de manière non commerciale, un système assurantiel pour couvrir ce coût pour les patients. En interne, il y a un mur tout à fait hermétique entre notre rôle de cogestionnaire de la sécurité sociale et les assurances facultatives [complémentaire], qui sont gérées par une structure en dehors de la mutualité (comme MCA). Les facultatives sont régies par le droit assuranciel et sont distinctes de l'assurance obligatoire. Je comprends que cela pose question, mais nous ne négocions pas avec deux casquettes. Au contraire, nous veillons à ce que nos assurances facultatives soient cohérentes et ne remboursent pas des choses auxquelles nous nous opposerions en assurance obligatoire. Lorsque nous négocions, ce n'est pas uniquement pour nos assurés facultatifs, mais parce qu'il y a beaucoup de personnes sans assurance hospitalisation. Nous devons absolument réduire les suppléments d'honoraires pour ces groupes. Le coût à charge du patient est un énorme problème en Belgique, il est beaucoup plus élevé que dans d'autres pays européens.
« Nous nous sommes opposés à l'augmentation du ticket modérateur pour une raison simple : un ticket modérateur s'applique de manière linéaire. »
Les syndicats médicaux avaient demandé d'augmenter le ticket modérateur. Il augmentera finalement d'un euro sur les médicaments remboursables. Ils proposaient un euro de TM supplémentaire sur la consultation. Vous vous y êtes opposée. Pourquoi ?
Nous nous sommes opposés à l'augmentation du ticket modérateur pour une raison simple : un ticket modérateur s'applique de manière linéaire et pèse beaucoup plus lourd sur les patients les plus précaires. Même avec des dispositifs comme le BIM ou le MAF, nous savons que les ménages les plus précarisés consacrent 6 % de leur budget aux soins de santé, contre 2 % pour les populations les plus favorisées. Un ticket modérateur élevé pèse donc lourdement et n'est pas proportionnel. Nous pensons également que la première ligne doit rester la plus accessible possible, car elle est la ligne de défense de la prévention, de la détection et de la proximité. Mettre des obstacles impacte surtout les gens qui sous-consomment déjà les soins de santé, en particulier la prévention. Nous étions contre l'augmentation du ticket modérateur sur les produits pharmaceutiques et les médicaments, maintenant ainsi notre cohérence. Cependant, nous sommes ouverts à la réflexion dans le cadre de la réforme de la nomenclature. Il y a sans doute des actes plus préventifs qui sont sous-valorisés. Il faut une vraie réflexion sur la proximité entre la valorisation de l'acte et la plus-value en santé. Je suis favorable à ce que les médecins généralistes soient suffisamment financés, notamment en leur permettant d'avoir une consultation préventive payée, comme chez les dentistes, ce qui pourrait améliorer l'accessibilité à la prévention.
Vous avez mentionné le BIM. J'ai entendu certains dire qu'il y en avait « trop » : 900.000 « vrais » BIM, et 3 millions en tout, ce qui serait excessif. Y a-t-il trop de BIM ?
Je comprends votre question. Il s'agit plutôt de 2 millions que 3 millions, ce qui correspond aux chiffres de la population à risque de pauvreté. Le BIM s'obtient de deux manières : par une analyse du revenu, ou de manière dérivée (ancien VIPO/Omnio) pour d'autres statuts, mais qui impliquent souvent aussi une analyse du revenu (personne handicapée, mineur non accompagné, veuf, orphelin). Je ne pense pas qu'il y ait trop de BIM. Le BIM n'est pas un revenu ; c'est une prévention majorée, permettant un remboursement différent, un ticket modérateur réduit chez le généraliste. C'est un statut permettant d'être mieux remboursé ou d'avoir accès à moins de quote-part personnelle, et de préserver les bénéficiaires des suppléments d'honoraires dans la nouvelle loi Vandenbroucke. Je ne pense pas qu'il y ait trop de BIM, car c'est un système extrêmement contrôlé. L'analyse ne se limite pas aux revenus, mais inclut aussi des éléments patrimoniaux, et l'accès aux données a été facilité. Nous savons qu'il y a un énorme sous-recours au BIM. De nombreuses personnes en situation précaire n'ont pas les preuves nécessaires pour justifier qu'elles ne gagnent pas assez pour y avoir droit. Je suis sceptique. Il y a sans doute quelques fraudes au BIM, de la même manière qu'il y a de la fraude fiscale (des gens très riches qui optimisent leurs revenus).
Concernant le maximum à facturer (MAF), le ministre souhaitait le rendre plus optimal. Soutenez-vous le ministre dans ce sens ?
Le problème du maximum à facturer réside dans les plafonds. Les seuils sont très vite atteints : 12 000 euros par an pour un ménage, c’est en dessous du seuil de pauvreté. Il faut donc revoir les plafonds. L'autre réforme proposée par le ministre, à laquelle je suis très favorable et que je trouve bonne, est d'intégrer une dimension soins psychiatriques et psychologiques, soit le MAF psy, incluant les hospitalisations. Il y avait une incohérence à ne pas tenir compte de certains soins de santé alors que l'on sait que tout contribue à l'état de santé. Je pense qu'une réforme du MAF est nécessaire, mais le MAF est très limité, notamment à cause des plafonds.
Bilan de Vandenbroucke
Concernant le ministre Frank Vandenbroucke (qui n'est pas de votre pilier politique), les mutualités se sont plaintes de son approche parfois cassante et de la mise à mal du système de concertation, même si sur le fond, il n'y avait pas toujours désaccord. Quel bilan faites-vous de son mandat et demi ?
Il y a deux éléments importants. Ce que j'apprécie chez le ministre, et je le dis sincèrement et publiquement, c'est qu'il a une vision et met en œuvre des réformes. Par exemple, la réforme des objectifs de soins de santé, la réforme hospitalière, et la réforme de la nomenclature. C'est un ministre qui maîtrise son sujet et qui veut faire évoluer le secteur, ce qui est une très bonne chose et dont nous avons besoin. Cependant, la tension apparaît lorsqu'il est trop convaincu de sa vision, ce qui empêche la gestion paritaire (une des forces du système de santé actuel) de jouer son rôle. Certaines mesures, même si nous sommes d'accord sur le contenu, ont une approche contre-productive. L'arrêté royal sur l'interdiction des suppléments d'honoraires chez les bénéficiaires BIM, par exemple, a généré beaucoup de tensions chez les médecins et les dentistes. C'est une très bonne mesure sur le fond, mais elle aurait dû être négociée dans le cadre des accords pour assurer la protection des publics vulnérables dans une réflexion globale sur l'accessibilité des soins. De même pour la lettre de mission. Bien qu'elle ne soit pas arbitraire intellectuellement (il a ciblé les plus gros secteurs), il anticipe parfois des décisions qui devraient émaner de la gestion paritaire. Une solution issue de la gestion paritaire serait peut-être moins dichotomique et aurait un vrai soutien du terrain, permettant aux acteurs de la mettre en œuvre. Actuellement, ces questions reviennent sans cesse parce que le terrain n'a pas été suffisamment impliqué.
Diriez-vous que son bilan est globalement positif ?
Pour le moment, nous sommes au milieu du gué, il est difficile de se prononcer. Je crois qu'il a commencé beaucoup de réformes nécessaires, mais il ne les a pas terminées. Pour que sa politique soit cohérente avec ce qu'il a promis, il doit les achever : il faut finir la réforme de la nomenclature et la réforme hospitalière.
« Le New Deal répondait aux attentes. Je m'interroge sur ce qui n'a pas fonctionné. »
Concernant la première ligne, on a l'impression qu'elle est constamment en crise et qu'elle se sent abandonnée. Fait-on vraiment tout ce qu'il faut pour la rendre efficace dans son rôle de prévention et de médecine de première instance ?
Il est vrai que nous en parlons beaucoup, mais que nous ne la soutenons pas toujours de manière adéquate. Par exemple, dans le projet de budget qui a été élaboré pour la Vivaldi, on voit des propositions de réinstitutionnalisation alors que l'on voudrait renforcer la première ligne à certains endroits. La première ligne est absolument fondamentale. Des efforts ont été faits (soins intégrés, New Deal), mais c'est une ligne de soin cruciale. Quant à savoir si elle est trop sensible ou sous pression, je ne suis pas sûre. J'ai été surprise qu'il y ait si peu de médecins adhérant au New Deal, qui pourtant répondait à plusieurs besoins de la première ligne.
Le New Deal est un échec relatif...
Oui, c'est un échec relatif. Pourtant, il répondait à des demandes de la première ligne, comme le soutien administratif, le travail en groupe, et l'intégration d'autres professions paramédicales. Je m'interroge sur ce qui n'a pas fonctionné.
Concernant l'échelonnement, êtes-vous favorable à un échelonnement relatif, soft, ou à une approche plus importante ? Quelle est votre position sur le concept d'échelonnement ?
Je suis favorable au principe de confier les tâches appropriées au bon niveau. Il faut aussi reconnaître le rôle important des acteurs dans la prévention. Cependant, je ne suis pas pour l'échelonnement absolu. Dans certaines situations complexes, je ne suis pas favorable au recours direct.
Êtes-vous contre le fait que le patient aille directement chez un spécialiste s'il en ressent le besoin ?
Je ne pensais pas nécessairement au spécialiste. Par exemple, nous avons eu le débat sur les kinés. Nous avons mis plusieurs limites à l'accès direct à la kinésithérapie, car dans des situations complexes, nous estimons qu'un avis médical préalable est nécessaire pour un suivi direct. Par contre, je pense que la vaccination en pharmacie est une bonne chose. Je serais plutôt pour renforcer le rôle vraiment préventif et holistique du médecin généraliste, avec une vraie consultation chez le généraliste qui reprendrait tous les aspects médicaux de la cartographie du patient. Inversement, il ne faut pas surcharger les généralistes, par exemple avec les certificats médicaux pour les absences de moins de trois jours, ou pour d'autres petits actes.
Malades de longue durée : l’importance du « TRIO »
Abordons le débat sur les maladies de longue durée et les invalides. Des économies sont demandées dans ce secteur. Faut-il responsabiliser les généralistes face à la maladie de longue durée, en sachant que des médecins conseils sont aussi impliqués ? Comment voyez-vous cette relation à trois, incluant le médecin du travail ? Est-ce que ce modèle fonctionne ? Cela ne risque-t-il pas de retirer au médecin généraliste la connaissance de son patient, alors qu'il sait très bien s'il a besoin d'un congé maladie ou non ?
Je crois vraiment au Trio. Je pense qu'il y a une vraie complémentarité des expertises. Le généraliste connaît le patient dans toutes ses dimensions, y compris sociales et familiales, il est donc essentiel qu'il reste la première porte d'entrée. La plus-value du médecin conseil est qu'il connaît très bien la médecine de revalidation. Il sait ce qu'il doit évaluer pour déterminer la capacité de travail et quelles sont les capacités restantes. Il faut donc une collaboration entre les deux. Le généraliste est moins formé à cela. Des projets visent à former les généralistes via la SMMG ou Domus Medica aux compétences liées à la médecine de revalidation. L'incapacité de travail dépend à la fois de la situation de santé et de la capacité à travailler dans un environnement de travail. Le médecin du travail peut se pencher sur les aménagements possibles, le médecin conseil évalue les capacités restantes et leur relation, et le généraliste connaît la situation de santé du patient. Ces trois acteurs doivent vraiment travailler ensemble.
Subissez-vous une pression du ministre, ou du gouvernement, pour que les mutuelles remettent les gens au travail et les fassent sortir du cercle vicieux de la maladie de longue durée ? Vous demande-t-on des résultats chiffrés ?
Il y a une très forte pression du gouvernement, et plus particulièrement de certains partis partenaires de la majorité que du ministre lui-même. Il faut distinguer deux aspects dans l'accompagnement des personnes en incapacité de travail. Premièrement, l'accompagnement médical est absolument nécessaire, car il s'agit d'abord de situations de maladie. Il faut un accompagnement juste pour évaluer les capacités à travailler. Deuxièmement, il y a des situations où un accompagnement direct est possible (personnes jeunes, incidents de vie résolus avec un bon accompagnement). Cependant, il y a aussi des situations plus complexes en fin de carrière. Si une personne a exercé un travail physiquement très lourd, on ne peut pas du jour au lendemain lui proposer une formation en comptabilité pour la réintégrer sur le marché du travail. Il faut donc faire la distinction. Les objectifs chiffrés que l'on nous donne manquent d'une vision d'objectif par rapport à l'incapacité de travail. Il faudrait distinguer beaucoup plus les situations pour avoir des interventions précises et adaptées. Sinon, on risque d'inciter les gens à reprendre trop vite, ce qui conduit à des rechutes et à une détérioration.