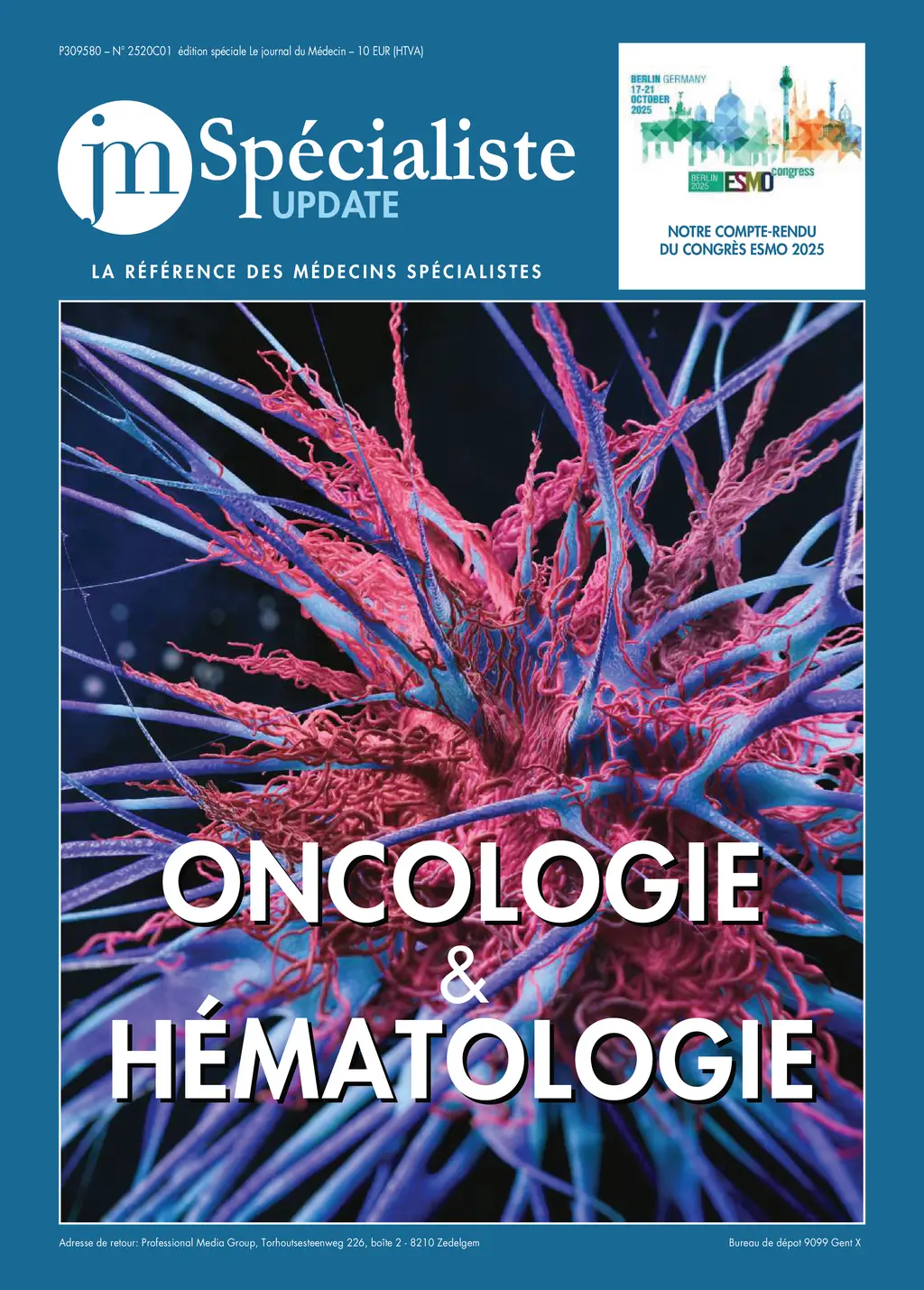Dossier pesticides
Quelle transparence dans les décisions publiques ?
Le dernier volet du dossier aborde la délicate question de la réglementation. Comment sont prises les décisions d’autorisation ? Quelle place accorder à l’indépendance scientifique ?
Laurent Zanella

Malgré les engagements politiques en faveur d’une réduction de l’usage des pesticides, le cadre décisionnel belge et européen reste largement favorable au statu quo.
Sans parler d'un processus sous influence, les scientifiques, médecins et associations pointent la lenteur du processus d’évaluation des substances actives, les dérogations fréquentes accordées aux produits interdits, et l’asymétrie entre les ambitions affichées dans le Green Deal et les mesures concrètes prises sur le terrain.
La lasagne institutionnelle n’aide pas la mise en œuvre cohérente des objectifs de réduction en Belgique. À l’échelle européenne, le poids des lobbies et les délais de réévaluation, parfois supérieurs à dix ans, affaiblissent le principe de précaution. D’autant que la connaissance scientifique, bien que disponible, peine à s’imposer dans l’arène décisionnelle.
Un processus complexe entre l’UE pour les substances…
L’autorisation des pesticides repose sur une double architecture : européenne pour les substances actives, nationale pour les produits commercialisés. Olivier Guelton, responsable de la cellule Autorisation des produits phytopharmaceutiques au SPF Santé publique, en détaille les rouages.
« En ce qui concerne les substances actives, leur évaluation, leur approbation et leur interdiction se passent au niveau européen », explique-t-il. Le processus associe la Commission, l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA), la DG Santé et les États membres, qui votent à la majorité qualifiée. L’approbation est limitée dans le temps et fait l’objet d’un réexamen. Certaines substances sont interdites d’emblée : « les substances actives cancérigènes 1A et 1B ; les substances mutagènes 1A et 1B ; les substances toxiques pour la reproduction 1A et 1B ; et les substances perturbant le système endocrinien », ainsi que divers composés très persistants et bioaccumulables.
L’évaluation scientifique s’appuie sur des lignes directrices communes, principalement rédigées par l’EFSA. « La méthodologie suivie pour effectuer les essais doit être approuvée par des instances internationales, par exemple l’OCDE », précise Olivier Guelton. « Seuls les laboratoires accrédités et audités régulièrement par les autorités nationales peuvent effectuer les études exigées. »
Les données proviennent presque exclusivement des industriels, mais des garde-fous ont été instaurés. « La rémunération du personnel qui va effectuer les essais pour le compte de l’industrie ne peut en aucun cas être liée aux résultats des études qu’ils vont effectuer », a insisté le responsable. Depuis peu, une double déclaration est imposée. « La société phytopharmaceutique notifie à l’EFSA son intention d’effectuer telle étude. Et le laboratoire qui va effectuer les études doit également notifier cela à l’EFSA. »
Si l’évaluation des risques semble balisée par un cadre scientifique rigoureux, les marges de manœuvre des autorités nationales restent limitées. « Les décisions sur les substances actives sont prises à la majorité qualifiée des États membres et sont contraignantes, y compris pour ceux qui ont voté contre », explique Olivier Guelton. Cela signifie que la Belgique, et a fortiori la Wallonie, ne peut interdire un produit dont la substance active a été autorisée au niveau européen, sauf à démontrer un risque sanitaire ou environnemental propre à son territoire. Une telle procédure, juridiquement complexe et scientifiquement exigeante, est rarement engagée.
…Et les États-membres pour les produits
L’autorisation des produits mis sur le marché relève quant à elle de la compétence des États membres. L’évaluation se fait selon un découpage en trois zones climatiques : sud, nord et centrale – cette dernière comprenant la Belgique, l’Allemagne et les Pays-Bas. « C’est un État membre de cette zone qui va faire l’évaluation pour l’ensemble des pays concernés. Ensuite, la Belgique, si elle est un membre concerné, reprend les conclusions de l’évaluation et prend une décision sur son propre territoire. »
Dans le système belge, les dossiers sont instruits par des évaluateurs du SPF Santé publique. « La demande est réceptionnée et des évaluateurs de notre SPF, qui ont au minimum un master dans une discipline scientifique, évaluent les demandes en appliquant les principes d’évaluation. » Une concertation interne est menée avant la soumission au comité d’agréation. « Cette proposition d’avis, pour chaque dossier, est portée à la connaissance de tous les membres du service. […] La proposition d’avis retenue est transmise aux membres extérieurs du comité d’agréation. »
Ce comité, composé d’experts des administrations fédérales, régionales, de Sciensano et de l’AFSCA, ne compte aucun représentant politique. « L’avis du comité est contraignant et doit être transposé en décision par notre service. » Chaque autorisation est délivrée pour une durée limitée, avec possibilité de réexamen si le titulaire du produit soumet une mise à jour de son dossier.
Conflits d’intérêts : une inquiétude persistante
Lors de son audition au Parlement wallon, le Dr Sébastien Cleeren, membre de la cellule environnement-santé de la SSMG, n’a pas mâché ses mots : « Il faut être lucide et voir les choses en face : dans ce genre de sujets, on nage dans des conflits d’intérêts et de la corruption. Appelons un chat un chat. » À ses yeux, les techniques d’influence développées par l’industrie chimique rappellent celles de l’industrie du tabac il y a quelques années : production d’études biaisées, experts financés par les fabricants, brouillage volontaire des preuves scientifiques.
Comme déjà mentionné dans ce dossier, le Dr Cleeren cite un contrat entre la SSMG et le SPF Santé publique sur les perturbateurs endocriniens, résilié à l’initiative des médecins généralistes après que le SPF leur aurait interdit de mentionner explicitement les pesticides comme source majeure d’exposition. « On ne peut pas se permettre, légalement, de mentir, même par omission », insiste le Dr Cleeren.
La démonstration du médecin s’appuie sur un exemple précis : celui du chlorpyrifos, un insecticide interdit en Europe depuis 2020 après 55 ans d’usage. Selon lui, des études indépendantes avaient pourtant révélé dès les années 1990 des erreurs méthodologiques grossières dans l’évaluation initiale du risque, notamment une revue financée par Dow Chemical, fabricant du produit, présentée à tort comme une étude scientifique. Pour le Dr Cleeren, cet exemple illustre le fonctionnement d’un système défaillant où « les experts qui défilent devant vous » devraient eux aussi être soumis à un examen des conflits d’intérêts.

Interpellé sur les conditions de production et de validation des études toxicologiques, Olivier Guelton a reconnu l’existence de défaillances ponctuelles. « Nous avons déjà eu des suspicions de faux certificats de ‘bonnes pratiques de laboratoire’ (GLP). On l’a signalé, on a pris des mesures. Nous avons déjà refusé des études. » Il précise que ces cas donnaient lieu à des demandes d’audit du laboratoire concerné. Si le laboratoire est situé en Belgique, l’inspection est assurée par l’autorité compétente nationale. À l’étranger, c’est l’autorité locale qui intervient.
Sur le principe même de ce système, où les études scientifiques sont financées par les demandeurs eux-mêmes, il ne nie pas une tension potentielle. Mais il assure que des garde-fous sont en place : la séparation stricte entre l’évaluation du risque (scientifique) et la gestion du risque (décisionnelle), l’absence de lien hiérarchique entre les deux pôles, et la possibilité d’audits indépendants en cas de doute. Il défend l’indépendance de ses équipes : « Ils parlent librement ; interrogez-les, vous verrez bien. »
Olivier Guelton évoque également la question sensible de la transparence. Les autorisations sont publiées sur Phytoweb, mais les refus ne le sont pas, « faute d’obligation légale et de moyens humains pour gérer cette diffusion », reconnaît-il. Il concède que la publication des évaluations scientifiques, tout comme celle des refus, pourrait renforcer la confiance du public, tout en exprimant des réserves pratiques : « Pour le grand public, cela ne va pas apporter d’information. Cela va apporter davantage de confusion », en raison de la technicité et de la langue (l’anglais) des documents. « Néanmoins, il y a matière à réflexion pour augmenter la confiance. »
Le besoin urgent de transparence
La transparence demeure l’un des angles morts majeurs des politiques wallonnes de réduction des pesticides. « Si l’on ne mesure pas, on ne connaît pas la situation », résume Olivier Hubert, conseiller à la Cour des comptes. Il pointe les déficiences structurelles du système de suivi. En Wallonie, il est actuellement impossible d’affirmer si l’usage des pesticides a diminué, augmenté ou stagné depuis 2004. Les données issues du Réseau d’information comptable agricole (RICA), utilisées pour estimer les quantités répandues, sont trop peu nombreuses et trop variables.
Cette opacité découle de deux failles majeures : l’absence de ventilation régionale des ventes de pesticides, toujours compilées au niveau national, et l’absence d’un registre électronique d’utilisation opérationnel. Ce dernier deviendra pourtant obligatoire dans toute l’Union européenne à partir du 1ᵉʳ janvier 2026.
La Wallonie mène une phase de test mais n’a, à ce jour, prévu ni centralisation des données ni outil d’exploitation. « Cela ne coûterait pas forcément plus cher et permettrait un contrôle bien plus efficace », insiste Olivier Hubert, appelant à renforcer la coordination entre agriculture, santé et environnement.
Le Pr Bruno Schiffers (ULiège), auditionné deux semaines plus tôt, va plus loin encore. Il évoque un « déni systémique » face à des faits scientifiquement établis. Selon lui, le Plan wallon de réduction des pesticides « n’a jamais réellement fonctionné ». Pourquoi ? Selon lui, à cause de l’opacité réglementaire, l’absence d’indicateurs robustes, et le fait que les recherches financées par la Région, comme EXPOPESTEN, ne soient pas intégrées aux décisions. Il fustige aussi les nombreuses dérogations pour des molécules interdites, octroyées au nom de la compétitivité.
Le Pr Schiffers réclame une refonte réglementaire, un soutien massif aux alternatives et une reconnaissance explicite du rôle central joué par la transparence : « C’est le premier levier de légitimité et d’efficacité pour toute politique environnementale crédible. »
Quelle place pour la société civile ?
Face à la complexité du débat sur les pesticides, les associations environnementales réclament une implication plus structurée et plus ambitieuse de la société civile dans le processus décisionnel. Devant le Parlement wallon, Virginie Pissoort, responsable plaidoyer pesticides pour Nature & Progrès, et Agathe Defourny, coordinatrice de Canopea, ont toutes deux souligné les lacunes démocratiques du système actuel et les leviers disponibles pour y remédier.

« Nous sommes à la treizième audition (en date du 8 juillet, d’autres auditions ont eu lieu depuis, NdlR), sans compter les nombreux avis écrits déjà transmis aux parlementaires », rappelle Virginie Pissoort en préambule.
Pour elle, la société civile a montré qu’elle était mobilisée, compétente et force de proposition. Elle déplore toutefois que les alertes formulées depuis des années – notamment sur les pesticides PFAS, l’absence de mesures pour les femmes enceintes ou encore l’érosion des sols – peinent à infléchir les décisions politiques. Le système d’autorisation des produits, qualifié de « passoire », est régulièrement contourné par des dérogations d’urgence, tandis que la Belgique autorise encore plus d’un quart de produits classés CMR (cancérogènes, mutagènes, reprotoxiques), certains étant même accessibles au grand public.
Agathe Defourny, quant à elle, alerte sur la dissonance entre les engagements institutionnels et les pratiques concrètes. « Le principe de précaution est vidé de son sens si l’on attend un risque avéré avant d’agir », dit-elle en appelant à un recentrage politique sur la prévention. Elle insiste sur l’importance de renforcer le rôle d’interface des associations entre les citoyens, les scientifiques et les décideurs. Canopea propose notamment de faire respecter le principe pollueur-payeur.
Les deux intervenantes pointent aussi un paradoxe : alors que les citoyens expriment un désir clair de réduction des intrants chimiques, leur implication dans les consultations publiques reste marginale, faute d’accessibilité des documents et de visibilité du débat. En 2022, à peine 80 réponses citoyennes ont été recueillies lors de l’enquête sur le Plan wallon de réduction des pesticides, malgré une mobilisation active des ONG.
Ce déficit de participation démocratique nourrit une forme de défiance envers les autorités. Pour y remédier, les associations appellent à un changement de paradigme, fondé sur la transparence, la reconnaissance de la légitimité citoyenne, et une vraie co-construction des politiques agricoles et environnementales. « Il ne s’agit pas d’arrêter les pesticides du jour au lendemain », résume Agathe Defourny, « mais de fixer un cap clair, soutenu politiquement, et de donner aux citoyens et aux agriculteurs les moyens d’y contribuer. »