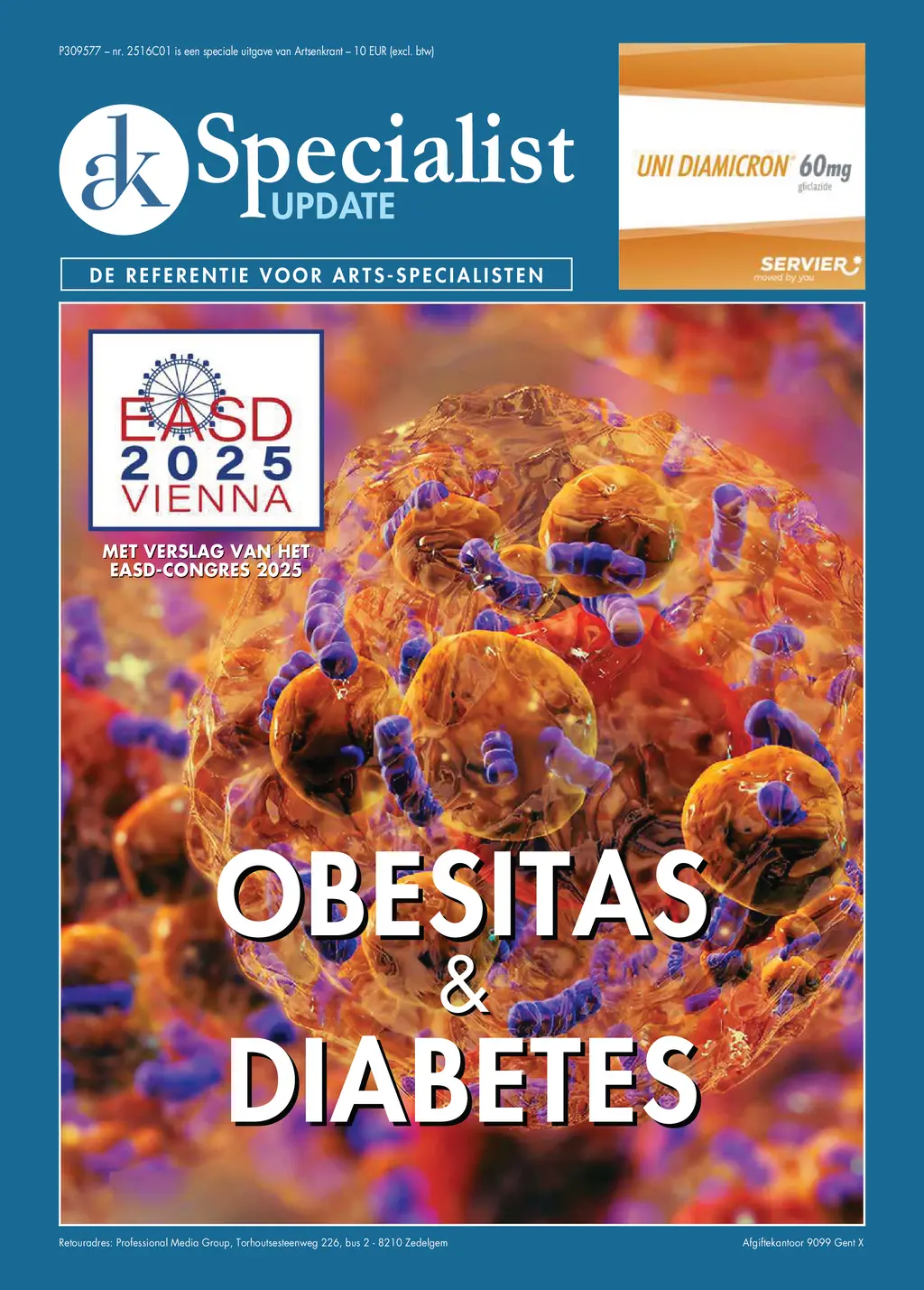Vandenbroucke réanime De Block pour réformer l’Ordre des médecins
En phase avec l’accord de gouvernement Arizona, le ministre de la Santé publique Frank Vandenbroucke a déterré un texte de projet de loi de 2016 en vue de réformer l’Ordre des médecins. Publicité des séances, centralisation de la procédure et rajeunissement des membres sont au menu. Si tout n’est pas à jeter, des médecins du Conseil provincial Bruxelles-Brabant wallon soulèvent quelques contradictions majeures.

À trop se focaliser sur le budget santé fraichement pondu, ou sur l’accord médicomut bientôt attendu, on risquerait de manquer d’autres réformes volontairement tues. Le ministre ne se repose pas. Un indice sur l’objet de son prochain chantier était pourtant dissimulé dans l’accord de gouvernement Arizona : « Les Ordres déontologiques existants pour les prestataires de soins de santé seront modernisés. Les problèmes (manque de transparence, position faible du patient) sont abordés dans ce cadre. »
L’Ordre des médecins, premier concerné, a été mis au parfum par une invitation à la concertation. Il apparaitrait que Frank Vandenbroucke a déterré un texte de 2016 qui, déjà sous Maggie De Block à l’époque, avait pour objet de réformer l’Ordre, mais n’avait pas abouti. « Nous sommes un peu surpris de voir ressurgir quelque chose qui a bientôt dix ans, même si le degré de technicité du texte montre qu’il a fait l’objet d’une réflexion déjà conséquente sur le sujet », s’étonne le Dr Frédéric Collart, président du Conseil provincial Bruxelles-Brabant wallon de l’Ordre des médecin. « D’un côté, les choses changent, le contexte évolue, et certaines mises à jour paraîtraient utiles. »
D’emblée, on pose un cadre important. Le Dr Collart et ses deux confrères qui s’expriment dans le cadre de cet article le font en leur nom propre, dans le cadre d’une réflexion générale sur le sujet, menée par un groupe de travail constitué au sein de leur Conseil provincial. Il précise également qu’une réforme de l’Ordre leur semble absolument évidente. « L’Ordre des médecins reste largement une boîte noire, une grande muette : il apparaît peu, on en sait peu de choses. Et face à la critique de l’entre soi, selon laquelle « ce sont des médecins qui se contrôlent entre eux », nous devons pouvoir répondre. »
Mais côté face de la pièce, ce sont plusieurs modifications majeures qui interrogent. Le texte prévoit, entre autre, la publicité des audiences (sous réserve de la possibilité de huis clos), pour démocratiser la structure. Structure qui serait elle-même modifiée : si le degré d’instruction (où l’on décide de poursuivre ou non) resterait à l’échelon provincial, le degré disciplinaire (où se tranche le fond de l’affaire), lui, serait transféré à un nouvel échelon, régional (francophone ou néerlandophone). Pour rajeunir l’Ordre, Vandenbroucke prévoit d’y faire entrer de jeunes médecins avec seulement trois ans de carrière à leur actif. Ci-dessous, trois médecins impliqués dans le groupe de travail du Conseil provincial Bruxelles-Brabant wallon ont répondu à nos questions pour tenter d’y voir plus clair.
Le journal du Médecin : Voyez-vous d'un bon oeil cette "meilleure place" pour le plaignant dans la procédure disciplinaire ?
Dr Frédéric Collart, néphrologue retraité du CHU Brugmann et président du Conseil provincial Bruxelles-Brabant wallon de l’Ordre des médecins : L’implication du plaignant dans la procédure est, sur le plan conceptuel, tout à fait utile et nous rapprocherait d’autres niveaux de justice où le plaignant est clairement impliqué. Mais nous y voyons d’emblée quelque chose d’extrêmement délicat. Aujourd’hui, compte tenu des réseaux sociaux, si un plaignant apprend qu’un médecin a été condamné, on peut très bien anticiper le risque de lynchage médiatique par des commentaires à gauche et à droite.
Quelles sont les contradictions majeures que vous relevez dans ce texte ?
Dr Frédéric Collart : Ce qui constitue le nœud du problème, selon nous, c’est la manière dont nous devrions procéder. Actuellement, quand une plainte est introduite, le bureau examine s’il y a lieu d’aller plus loin. Si oui, nous créons une commission d’instruction qui évalue le dossier et rend rapport devant le Conseil pour déterminer dans quelle mesure le médecin doit être convoqué en conseil disciplinaire. C’est alors l’instance disciplinaire qui juge à proprement parler les faits qui lui sont soumis. Tout cela se passe au sein du même conseil, donc de la même province. D’où une critique possible : comme il faut séparer scrupuleusement l’instruction du disciplinaire. Mais dès lors que certains membres peuvent se retrouver à différents stades de la procédure, celle-ci n’est pas parfaite.
Le projet de réforme apporte une autre vision : le niveau d’instruction resterait au niveau des provinces, alors que le jugement disciplinaire se ferait au sein d’une instance régionale, une néerlandophone et une francophone.
Dr Frédéric Collart : C’est là que nous voyons quelque chose qui nous paraît difficile. Il ne s’agit pas de dire « c’était mieux avant », mais de dire que la justice actuelle fonctionne relativement bien, au vu du faible nombre d’appels contre nos jugements. L’échelle provinciale nous permet aussi d’adapter notre manière de gérer les problèmes en tenant compte des réalités locales. Nous sommes convaincus que le Luxembourg n’est pas Bruxelles, et que la manière dont les problèmes s’y posent n’est pas exactement la même.
« L’échelle provinciale nous permet aussi d’adapter notre manière de gérer les problèmes en tenant compte des réalités locales. Uniformiser au niveau régional ne nous paraît pas nécessairement souhaitable. »
- Dr Frédéric Collart
Nous craignons que ce niveau régional, au nom de l’uniformisation de la prise en compte des problèmes, soit une erreur conceptuelle : uniformiser ne nous paraît pas nécessairement souhaitable. Une telle instance aurait une charge de travail absolument considérable ; cela supposerait probablement une professionnalisation des personnes avec, de prime abord, un poids probablement plus important des magistrats par rapport aux médecins dans la gestion de la procédure. Voilà qui risque de trop ressembler à des tribunaux traditionnels, alors que, pour la médecine, le concept d’audit par les pairs demeure la bonne approche.
En définitive, nous avons vraiment l’impression que le système actuel fonctionne assez bien : il y a l’audit par les pairs, le contrôle du magistrat, et les possibilités d’appel. Nous sommes toutefois confrontés à des difficultés de disponibilité des magistrats. Les procédures prennent donc du temps, ce qui est très négatif pour l’image de la procédure elle-même.
Justement, ces « pairs » dont vous parlez, Vandenbroucke veut les rajeunir…
Dre Zohra Fellah, médecin généraliste à Anderlecht : le projet de réforme parle de faire siéger de jeunes médecins ayant trois ans de pratique. C’est impossible d’avoir l’expérience nécessaire pour juger dans ces conditions. Prenez un médecin de 72 ans qui a commis une faute déontologique : comment, après trois ans d’exercice, peut-on juger un confrère qui a autant d’années d’expérience ? Je pense qu’il faut au minimum sept ou huit ans de pratique, et moi je dirais même dix ans.
Dr Frédéric Collart : Concrètement, Vandenbroucke, a adressé une invitation au Conseil national à participer à des réunions de lecture du projet 2016 pour le commenter et l’adapter. Après, jusqu’où pourra-t-on aller dans l’adaptation ? Changer des points-virgules, c’est une chose. Mais je pense que tous les conseils provinciaux ont émis cette critique quant à l’hypothèse de permettre à des médecins n’ayant que trois ans d’ancienneté de siéger : cela nous paraît trop peu. La proposition a été faite de reprendre le même critère que pour la nomination des maîtres de stage, soit au moins dix ans d’ancienneté.
Dre Zohra Fellah : Par ailleurs, on nous présente parfois comme des « vieux grincheux » brandissant le bâton. Ce n’est pas du tout le cas, et j’en suis la preuve : je ne suis pas si vieille, je n’ai pas de cheveux blancs (rires). Il y a de plus en plus de femmes, ce qui apporte une autre approche, la féminisation progresse au sein des conseils. Ce sont des personnes qui ont fait acte de candidature, élues par leurs collègues : des médecins motivés, qui prennent leur travail à cœur. Nous faisons notre travail avec passion ; ce n’est pas toujours facile, mais nous le faisons. Notre président a même organisé des « samedis-marathons » - de 9 h jusqu’au « finish » - pour résorber le retard des dossiers ; nous en avons déjà tenu quatre, et cela a permis de se remettre à jour dans de nombreux dossiers. Il y a donc une volonté de bien faire, de travailler correctement et avec bienveillance, tout en respectant le cadre : on ne peut pas laisser exercer un médecin sous l’influence de stupéfiants, ou qui fait n’importe quoi, ou qui entache la réputation de notre métier.
« Quand j’étais jeune, le médecin, le notaire, l’avocat étaient des figures très respectées. Aujourd’hui, on 'dégrade' l’estime pour ces professions, alors qu'il faut préserver leur notoriété. »
- Dre Zohra Fellah
Quand j’étais jeune, le médecin, le notaire, l’avocat étaient des figures très respectées. Aujourd’hui, on « dégrade » l’estime pour ces professions. Il ne faut pas que nous soyons jugés comme un toxicomane ou une personne qui a volé le sac d’une dame, par exemple. Il faut préserver la notoriété de notre profession. Et s’il doit y avoir un représentant, un président au niveau du Conseil, cela doit être un médecin : à l’Ordre des avocats, c’est un bâtonnier ; à l’Ordre des pharmaciens, un pharmacien ; chez les journalistes, un journaliste ; chez les dentistes, un dentiste ; chez les kinés, un kiné. N'importe qui ne peut pas présider un Ordre - mais ce n’est que mon avis.
Le ministre Vandenbroucke s’imice-t-il trop loin dans la déontologie médicale ?
Dr Pierre Hoffreumon, médecin anesthésiste-réanimateur à la Clinique St-Pierre d’Ottignies : La déontologie médicale se fonde sur le savoir et sur le savoir-faire du médecin (au regard des connaissances scientifiques validées du moment. Tout cela évolue au fil du temps, c’est pourquoi nous sommes favorables à une amélioration de cette loi. Mais avec une refonte d’une telle ampleur, nous craignons une mainmise - ou, à tout le moins, une implication - du politique via une certaine fonctionnarisation des membres de ces conseils. Déjà, les magistrats sont nommés par le ministre. Si l’on commence à fonctionnariser des médecins, du fait de l’effet de masse que constituerait une instance disciplinaire régionale, on risque de perdre la spécificité de cette juridiction disciplinaire, qui n’a rien à voir avec la justice civile ou pénale et qui doit en être clairement séparée.
Dans l’esprit de rationalisation des moyens qui traverse tout l’accord de gouvernement de l’Arizona, cette réforme est-elle motivée par des questions d’économies d’argent ?
Dre Zohra Fella : Non ! Les médecins qui siègent au Conseil ne sont pas rémunérés. Certains pensent qu’on siège au conseil disciplinaire et qu’on prononce des sanctions parce qu’on est payés pour ça. Il s’agit de jetons de présence, taxés fiscalement, et je peux vous assurer que ce ne sont pas des jetons comme ceux des ministres. Vandenbroucke veut faire des économies, mais si ce projet de réforme passe, je crois que cela lui coûtera plus cher.
Dr Frédéric Collart : L’Ordre des médecins ne coûte rien à l’État, rien du tout, puisque nous sommes financés exclusivement par les cotisations. Le secrétariat, le chauffage de nos bâtiments, etc. : tout est payé par les cotisations.
« L'Ordre des médecins ne coûte rien à l'État, et c'est un gage d'autonomie ! »
- Dr Pierre Hoffreumon
Dr Pierre Hoffreumon : Et c’est un gage d’autonomie ! Et la loi d’origine l’avait bien compris en 1967 : elle a créé l’Ordre des médecins et, en son sein, trois organes : le Conseil national, les conseils provinciaux et le Conseil d’appel, qui sont trois organes complètement séparés. La loi les décrit de manière très précise et ne crée aucun lien de subordination entre eux, ce qui est encore un gage d’indépendance et d’autonomie. C’est peut-être là le message principal de nos interrogations actuelles au sein du Conseil.
Le texte de réforme annonce qu’il veut rendre les séances publiques. Je pense qu’actuellement, ce n’est pas le cas. Qu’en pensez-vous ?
Dr Frédéric Collart : Tout à fait, ce n’est pas le cas au niveau provincial : notre travail se fait entre nous. Le Conseil d’appel, par contre, est une structure ouverte au public, mais l’on constate qu’il y a très peu de demandes pour participer aux séances. Je ne vois pas d’objection de principe à la présence d’un public, quel qu’il soit, pour autant, bien entendu, que l’on puisse recourir au huis clos lorsqu’il faut discuter, par exemple, de données couvertes par le secret médical, etc. Il faudra donc trouver la bonne manière de s’« ouvrir » au public et aux plaignants, avec la difficulté déjà évoquée du risque de lynchage public.
On entend que vous acceptez tout à fait l’idée d’une réforme, jugée bienvenue, mais que vous n’appréciez pas la méthode. Quelle voie proposez-vous alors pour réformer l’Ordre ?
Dr Pierre Hoffreumon : La réforme pourrait se concentrer sur une optimisation de l’Ordre. Ne pourrait-on pas envisager d’allouer des ressources per capita aux différents conseils provinciaux, au lieu de créer un « comité Théodule » qui superviserait l’ensemble du bassin ? Il suffirait d’allouer des moyens suffisants. Voyez : entre le Conseil provincial Bruxelles–Brabant wallon et le Conseil provincial Luxembourg, il y a un rapport de un à dix en termes de nombre de médecins membres. Pourtant, l’organisation des conseils provinciaux, telle que définie par la loi, est identique pour tous. En optimisant les ressources, on gagnerait déjà beaucoup.
Au niveau des mesures que le conseil disciplinaire peut prendre, il y a également des modifications : la suspension du prononcé va être introduite, tout comme l’effacement et la rhéabilitation. Qu’en pensez-vous ?
Dr Frédéric Collart : C’évidemment tout à fait positif. On ne peut pas, pour un problème minime qui a peut-être entraîné une sanction - fût-ce une semaine de suspension -, garder cela au dossier toute la vie : cela n’a pas de sens. L’instauration d’une procédure d’effacement ou de réhabilitation, quel que soit le nom qu’on lui donne, nous paraît donc pertinente. Sans oublier qu’à côté de cela, il existe des faits graves qui, eux, doivent évidemment rester consignés et précisément documentés au dossier.
Dr Pierre Hoffreumon : Lorsque l’exposé des motifs du projet de réforme affirme qu’il faut uniformiser les sanctions, je pense que le Conseil d’appel est déjà là pour cela (entre autres) : uniformiser les sanctions entre les différents conseils provinciaux. C’est réinventer l’eau tiède que de dire « on va créer une instance interprovinciale pour uniformiser les sanctions ».