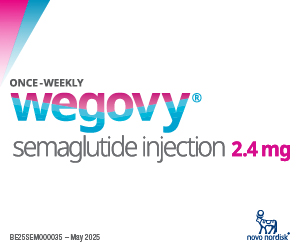Tuer des humanitaires : à quel coût ?

Le samedi 3 mai, chez Médecins sans frontières (MSF), nous nous sommes réveillés sous le choc, remplis de douleur et d’indignation. Notre hôpital d’Old Fangak, au Soudan du Sud, avait été pris pour cible : un hélicoptère de combat a détruit la pharmacie, suivi de bombardements, puis des drones ont frappé le marché voisin. Patients et personnel ont dû fuir, tandis que les éclats d’obus ravageaient l’hôpital. Cette attaque, non seulement terrifiante, constitue une violation grave et manifeste du droit international humanitaire [1].

secrétaire général de MSF
Ce même sentiment de sidération nous a submergés à l’annonce de deux autres attaques massives, tout aussi atroces, qui ont coûté la vie à des travailleurs médicaux ces dernières semaines.
Le 23 mars, l’armée israélienne a tué 15 personnes à Gaza, dont huit membres du Croissant-Rouge palestinien. Huit jours plus tard, leurs corps ainsi que leurs véhicules détruits ont été découverts dans une fosse commune. Des vidéos ont montré que l’attaque ciblait délibérément des soignants clairement identifiés, ainsi que des ambulances. Aucun acheminement d’aide n’avait été autorisé dans la bande de Gaza le mois précédent, un siège total qui perdure à ce jour.
Le 11 avril, dans le camp de déplacés de Zamzam, au Darfour-Nord, au Soudan, neuf agents humanitaires de l’organisation Relief International ont été tués de sang-froid. Des soldats des Forces de soutien rapide ont pris d’assaut une clinique — la dernière encore fonctionnelle — lors de leur offensive contre le camp.
Ces exemples ne sont que les plus récents — et les plus choquants — parmi les attaques perpétrées contre des travailleurs médicaux et humanitaires à travers le monde. Nous avons également été témoins de violences terribles en Ukraine, en Haïti, en République démocratique du Congo, et ailleurs. Qu’elles ciblent directement des équipes ou des structures de MSF ou d’autres organisations, ces attaques nous touchent profondément en tant qu’humanitaires. Nous partageons le deuil de tous nos collègues médicaux et humanitaires, unis par la même urgence : soigner, protéger et secourir, malgré les dangers.
Ces attaques récentes revêtent une gravité exceptionnelle — non seulement par leur brutalité et le nombre de victimes, mais aussi par l’indifférence abyssale qui a suivi. Au-delà de quelques déclarations des Nations unies et d’appels isolés de certains États — comme le Royaume-Uni, qui a demandé des enquêtes sur les attaques à Gaza, ou la France, après la frappe sur l’hôpital d’Old Fangak — il n’y a pas eu d’indignation collective à l’échelle mondiale. Aucun élan politique fort, et surtout aucune mesure concrète pour sanctionner les responsables. Les condamnations verbales restent vaines si elles ne s’accompagnent pas de conséquences tangibles.
Il semble presque vain de poser la question : qu’est-ce qui empêchera que cela se reproduise… dès demain ?
Toute attaque de cette nature devrait déclencher une condamnation ferme, claire et immédiate. Nous devons exiger des réactions indignées, des mobilisations concrètes, des réponses sans ambiguïté. Des enquêtes indépendantes doivent être systématiquement ouvertes pour identifier les responsables. Les lois existantes et les conventions internationales doivent être appliquées sans compromis ni délai. La justice doit être rendue aux familles et aux collègues des victimes, et une pression réelle exercée sur les acteurs politiques qui tolèrent, facilitent ou encouragent ces violences.
Faute d’une réponse internationale à la hauteur, il semble que les auteurs de ces attaques agissent de plus en plus en toute impunité. Quel prix politique, juridique, économique, social ou moral paient-ils ? Quel État, quelle instance, quelle institution est réellement prête et déterminée à les tenir pour responsables ? Il devrait être impensable que tuer des humanitaires ou du personnel médical — des personnes qui mettent leur vie en danger pour soigner — reste sans aucune conséquence. Il ne s’agit pas seulement de préserver notre capacité à exercer notre mission : c’est la défense même de valeurs fondamentales, telles que la solidarité et l’humanité, qui est en jeu.

Soyons clairs : les attaques contre les soignants et les travailleurs humanitaires ne sont pas nouvelles. Nous ne nourrissons aucune illusion nostalgique d’un « âge d’or » où notre travail aurait été universellement respecté ou notre sécurité garantie. Au contraire, MSF a toujours dénoncé ces violences et exigé un changement. En 2016, après une série d’attaques contre notre personnel — notamment le bombardement de l’hôpital de Kunduz en Afghanistan par les États-Unis — et face aux campagnes systématiques visant les hôpitaux en Syrie et au Yémen, nous avons soutenu l’adoption de la résolution 2286 du Conseil de sécurité de l’ONU, qui vise à protéger les blessés, les malades, le personnel médical et les travailleurs humanitaires en temps de conflit. Mais depuis, les résultats ont été dramatiquement insuffisants.
Tuer des travailleurs humanitaires ne devrait pas seulement
avoir un coût. Cela doit être un prix que personne
ne puisse jamais se permettre de payer.
Nous ne sommes pas seuls dans ce combat. Le Comité international de la Croix-Rouge continue de s’engager à travers la campagne « Les soins de santé en danger ». En 2024, le Conseil de sécurité de l’ONU a adopté la résolution 2730 — une initiative de la Suisse — appelant tous les États à respecter et protéger les travailleurs humanitaires. La même année, un groupe interministériel réunissant l’Australie, le Brésil, la Colombie, l’Indonésie, le Japon, la Jordanie, la Sierra Leone, la Suisse et le Royaume-Uni a publié une déclaration commune, affirmant sa volonté d’élaborer une nouvelle Déclaration pour la protection du personnel humanitaire. Mais, jusqu’à présent, cet effort collectif est resté sans suite concrète. Nous n’avons pas constaté la transparence, la responsabilité ni les changements nécessaires. Il est même rare d’obtenir une simple reconnaissance des faits de la part des auteurs de ces attaques.
La mort et les blessures infligées aux soignants et aux humanitaires s’inscrivent souvent dans un schéma plus large — tout aussi inacceptable — de violences indiscriminées, voire délibérées, contre les communautés qu’ils accompagnent. À Gaza, plus de 52 000 personnes ont été tuées depuis le 7 octobre 2023, selon les autorités locales. Au Soudan, il est impossible d’estimer précisément le nombre de victimes civiles, mais certaines études évoquent plusieurs centaines de milliers de morts.
Aujourd’hui, face à des attaques sans précédent contre les institutions multilatérales, les Nations unies et les mécanismes juridiques — comme en témoigne l’opposition croissante à la Cour pénale internationale — ce n’est pas seulement l’absence de justice ou de pression politique qui pose problème, mais bien le démantèlement délibéré des canaux qui permettraient d’agir. Nous appelons toutes celles et tous ceux qui croient encore en l’humanité et en la solidarité à condamner fermement ces attaques. Partout dans le monde, leur mobilisation et la diffusion d’appels renouvelés à la justice et à la responsabilité sont indispensables. Les citoyens doivent exiger que les États qui se réclament du droit international prennent des mesures concrètes et exercent une pression politique pour mettre fin à la banalisation et au silence qui entourent les attaques contre les soignants et les humanitaires — à Gaza, au Soudan, au Soudan du Sud, et ailleurs.
Plus que jamais, nous avons besoin que les parties en conflit — ainsi que les États qui les soutiennent politiquement, économiquement ou militairement — reconnaissent qu’attaquer et tuer des humanitaires, c’est s’attaquer aux valeurs mêmes qu’ils prétendent défendre.
[1] Publié initialement sur swissinfo