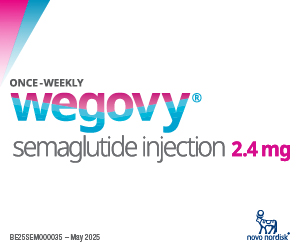Violences conjugales: comment s'y prendre?

Comment prendre en charge les violences conjugales? Un sujet difficile, auquel les médecins étaient auparavant peu préparés. Mais, de plus en plus, grâce notamment à davantage d'interdisciplinarité, médecins de première et de deuxième lignes s'emparent de la question. Des outils existent pour les aider.
Discuter des violences que l'on subit, ce n'est jamais évident. Il existe heureusement des ressources pour aider les professionnels de santé à soutenir les victimes. C'est le cas de "Ça vaut pas l'coup", un service de première ligne spécifiquement dédié aux violences conjugales en province de Namur. Le service, gratuit, accueille et accompagne les personnes victimes de violences conjugales. Il intervient également dans toute la province auprès des professionnels via des sensibilisations et formations.
Différencier conflits et violences
Présentes au dernier symposium des services d'urgence et de soins intensifs du CHRSM - site Meuse sur la médecine légale organisé en janvier dernier, Mmes S. Gratien, assistante sociale et S. Torino, psychologue, plantent le décor. "Il faut d'abord distinguer conflits et violences", explique Mme Torino. "Les conflits, ce sont des discordes ponctuelles. Les violences conjugales, elles, perdurent dans le temps. Les violences conjugales sont cycliques. Ensuite, il y a un espace de négociation, d'existence que l'on retrouve dans les conflits mais que l'on ne retrouve pas dans les violences conjugales où le phénomène de la peur de l'autre est plus présent."
Il est possible d'orienter vers le service d'assistance aux victimes de la zone de police, la ligne d'écoute 0800/30.030, ainsi que le site internet www.ecouteviolencesconjugales.be qui propose notamment un répertoire listant divers services.
Les différentes formes de violences apparaissent progressivement et coexistent ensuite. "Les violences sont insidieuses. Elles s'immiscent dans la vie des victimes sans qu'elles ne s'en rendent compte. Cela commence souvent par des violences psychologiques, par le contrôle vestimentaire, des sorties, des fréquentations, de la surveillance, etc." Viennent ensuite les violences verbales, et financières. Certaines victimes peuvent se voir confisquer leur argent, interdire d'aller travailler ou de se former. Pour d'autres, on cachera les documents administratifs. D'autres violences peuvent également survenir contre les objets (symboles tels que les photos, les souvenirs) ou contre les animaux. Enfin, il y a potentiellement des violences physiques et sexuelles. "Selon la théorie, ces dernières arrivent après les violences physiques. Nous ne sommes pas vraiment d'accord avec cela car il est difficilement concevable d'avoir un rapport consenti avec une personne qui nous abuse psychologiquement ou verbalement", avance la psychologue.
Cycle de la violence
Les violences conjugales, nous l'avons dit, sont cycliques. Elles s'articulent généralement en quatre phases. ""Le cycle de la violence démarre, selon moi, habituellement plutôt à la lune de miel, car le début de la relation n'est généralement pas marqué par la tension", explique Mme Gratien. "Le climat de tension apparaît par la suite avec des paroles, des attitudes. Peu à peu, la victime se met à douter d'elle, a peur de déplaire, de faire des erreurs. Après ce climat de tension survient la crise, avec un passage à l'acte. S'en suit la colère et la tristesse, l'humiliation, le désespoir pour les victimes. Vient ensuite une phase de justification, celle de l'auteur et celle de la victime. L'auteur, lui, va minimiser le passage à l'acte, se déresponsabiliser, trouver des excuses. La victime, elle, va prendre la responsabilité du passage à l'acte sur elle, va donner raison à l'auteur. On revient ensuite vers une période lune de miel où l'auteur s'excuse, est plus attentionné. Mais le cycle reprend. Et plus le cycle se répète, et plus la victime va se percevoir comme incompétente."
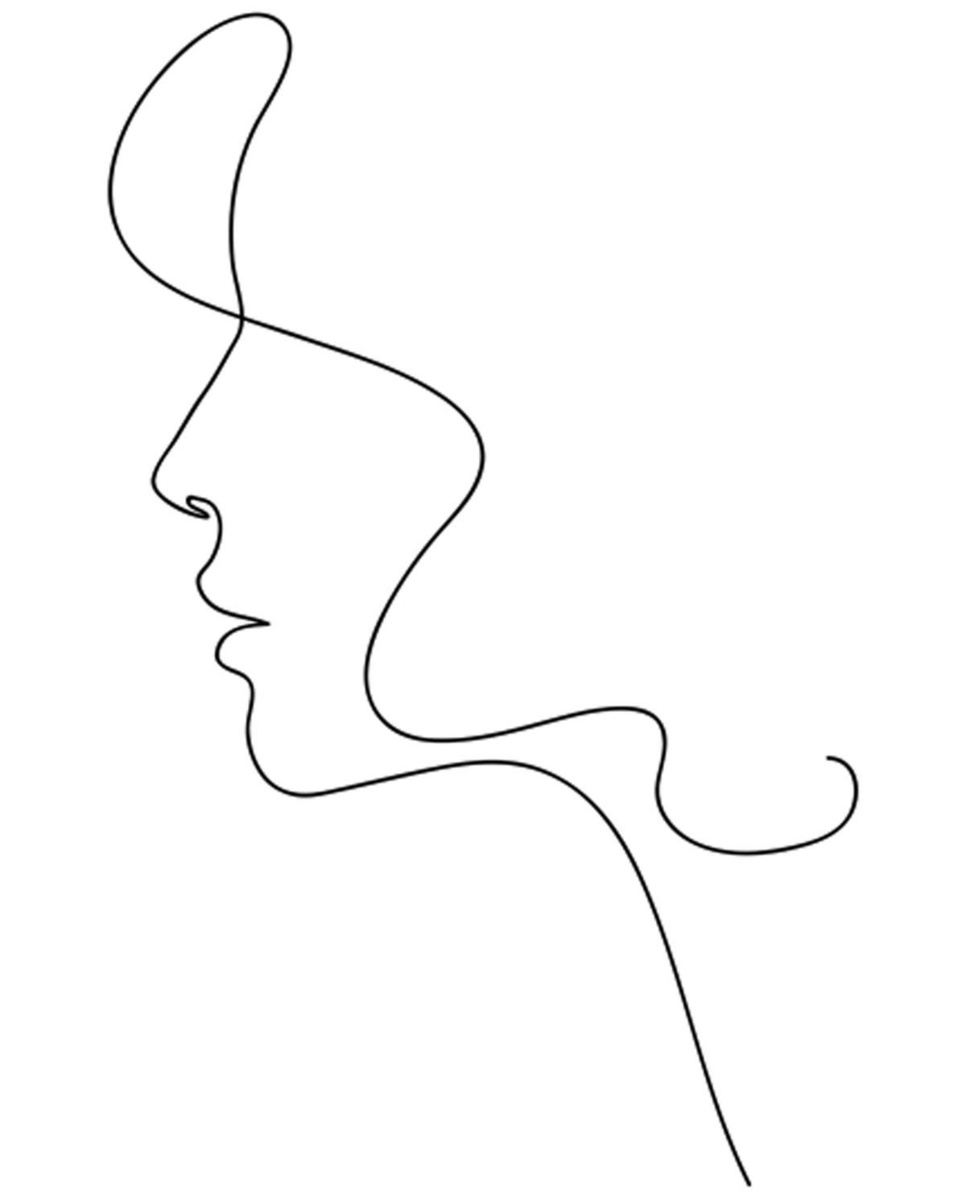
"Les deux phases de tension et de crise sont des phases de prise de contrôle, tandis que les phases de justification et de lune de miel sont des phases de récupération. L'auteur a conscience qu'il a posé un acte violent et avec la justification et la lune de miel, il va recentrer la victime sur les avantages de la relation", ajoute Mme Torino.
"Il suffit de partir"
Pour échapper à ce continuum de violence, il suffit de partir, pensent certains. Malheureusement, cela n'est pas aussi simple. "La séparation peut amener un auteur de violence, en perte de contrôle, à être d'autant plus violent envers sa victime. Cela est d'autant plus pernicieux avec la présence d'enfants et l'instrumentalisation de ces derniers pour atteindre la victime", rapporte l'assistante sociale.
"La victime et l'auteur sont liés par un lien affectif qu'il est important de comprendre. L'auteur connaît parfaitement la victime. Il connaît ses points faibles et il peut axer sa stratégie sur ces points faibles, ajuster ses comportements en fonction de la réaction de la victime par rapport à ses stratégies. La période de séparation est donc un moment très dangereux par rapport aux violences conjugales. C'est à ce moment-là que l'on constate le plus de féminicides", constate la psychologue.
Différents facteurs de risques
Personne n'est prédisposé à vivre des violences conjugales. Néanmoins, il existe des facteurs de risques. "Sur le terrain, nous avons environ 150 nouveaux dossiers par an. Cela concerne une majorité de femmes plutôt jeunes, avec un faible niveau d'instruction, et qui sont issues d'un milieu socio-économique pauvre", constate Mme Gratien. "Cela favorise une prise de contrôle."
Les antécédents de violence au niveau intrafamilial, les dépendances à la drogue, à l'alcool, les problèmes de santé mentale, la dépression, l'anxiété, ou encore la grossesse sont autant de facteurs aggravants.
Petit focus sur les violences conjugales pendant la grossesse (lire également l'encadré). On estime que 3 à 8% des femmes enceintes ont subi des violences conjugales. "Même au sein des couples où aucune violence antérieure n'est à déplorer, la grossesse peut être mal vécue. Pour certains, elle peut mettre à mal la fusion des futurs parents. Et c'est là que l'on voit apparaître progressivement de la violence. Dans d'autres cas, la violence est déjà présente et la grossesse va aggraver les violences conjugales. Dans un couple où il y a de la violence conjugale, la parentalité n'existe pas pour l'auteur qui reste focalisé sur la victime."
En consultation
Quelques signes peuvent alerter, notamment la présence de séquelles physiques. Mais les violences sont souvent plus insidieuses. Le comportement de la victime - prise de parole compliquée, regard fuyant, hypervigilance,...- peut attirer l'attention du médecin, au même titre que le comportement du/de la conjoint(e), qui laissera peu de place à la victime. "Si vous avez des doutes, essayez de voir la potentielle victime seule", conseille Mme Torino.
"En consultation, partez toujours de questions ouvertes et affinez peu à peu", continue la psychologue. "Comment ça se passe à la maison? Est-ce qu'il y a des tensions particulières? Oui? Par rapport à quoi et comment cela se règle d'habitude?" Si les difficultés relationnelles se confirment, on peut alors poser des questions plus fermées.
Il se peut que le médecin soit confronté au déni ou à la minimisation des victimes. "On peut agir sur le cycle du changement. Pour initier un changement, il faut se rendre compte qu'il y a un problème suffisamment grave que pour entamer ce changement. Pour ce faire, on va faire douter la victime de sa situation. Il est très important de suivre et de respecter le rythme de la victime tout en faisant attention à sa sécurité."
Comment faire? "On part de ses inquiétudes: 'Je m'inquiète pour vous, vous savez? '", répond la psychologue. "On peut également exprimer le fait que le comportement du conjoint n'est pas normal, voire inacceptable. On peut également faire le lien entre un état ressenti par la victime - la fatigue par exemple - et les violences conjugales. Les enfants peuvent également constituer un levier pour obtenir un déclic. Attention, cela peut également être culpabilisant pour la victime."
En cas de dévoilement, la victime peut être amenée à vider son sac, mais cela n'est pas toujours le cas. "Quoi qu'il en soit, il sera intéressant d'aborder les mécanismes qui se mettent en place dans les cas de violences conjugales, de rappeler que cela n'est pas autorisé par la loi, de rappeler les responsabilités de chacun, y compris celle de la victime", explique Mme Gratien. "La victime est effectivement responsable de sa sécurité et de celle de ses enfants lorsqu'il y en a."
"Donnez également des informations à la victime sur la prise en charge de son cas. Même si elle n'est pas réceptive immédiatement, cela sera utile", conseille enfin Mme Torino. Il est possible d'orienter vers le service d'assistance aux victimes de la zone de police, la ligne d'écoute 0800/30.030, ainsi que le site internet www.ecouteviolencesconjugales.be qui propose notamment un répertoire listant divers services (jeunesse, juridique, maisons d'accueil spécialisées, services ambulatoires spécialisés). Une aide est également disponible pour les auteurs de violences dans le milieu familial via l'asbl Praxis www.asblpraxis.be.

Les étudiants sensibilisés à Namur
À l'UNamur, les futurs médecins (Bac 3) ont, depuis deux ans, l'occasion de mieux appréhender les violences faites aux femmes et ce, de manière très originale. Les étudiants en médecine de l'UNamur suivent, depuis peu, 20 heures obligatoires de travaux pratiques "communication professionnelle en santé", créés et coordonnés par Hélène Givron (psychologue clinicienne, PhD et maître de conférences à l'UNamur) et le Pr Martin Desseilles (psychiatre et directeur du département de psychologie de l'UNamur). "Dix heures sont consacrées à la communication soignant-soigné et 10 heures à la communication soignant-soignant", explique l'intéressée.
C'est dans ce cadre que les étudiants ont participé à un Escape Game créé par deux sages-femmes de l'Henallux, Milena Jarosik et Sophie Evrard, et financé par un prix Solidaris. L'objectif pour les étudiants: répondre à huit énigmes en partant d'un cas concret pour arriver à trouver le 0800/30.030. Nouveauté en 2024, les 162 étudiants en médecine ont été rejoints par une cinquantaine d'étudiantes sages-femmes. L'occasion de constater qu'en Bac 3, loin du terrain, les futurs médecins n'ont pas la maturité de leurs collègues sages-femmes qui ont déjà vécu des stages. "Cela nous a permis de travailler la collaboration en équipe et briser les silos professionnels", explique Hélène Givron. "Cela permet de mettre en valeur l'interdisciplinarité, de montrer que les sages-femmes font aussi un travail de première ligne", explique Milena Jarosik.